« The hardboiled dicks » ou « les privés durs à cuire ». Le terme hardboiled, qu’on emploie pour parler d’une personne insensible, est apparu dans l’argot de la Première Guerre mondiale. Il a commencé par désigner les sergents responsables des parcours du combattant qui passaient les civils à la moulinette pour en faire des citoyens-soldats. L’argot créé en temps de guerre a tendance à suivre les soldats lorsqu’ils sont de retour chez eux et à survivre à la fin des combats. Le dur à cuire est devenu n’importe quelle personne qui ne montre pas de sympathie particulière pour vos problèmes.
Le terme dick, dans ce contexte – et je ne saurais en considérer aucun autre ici –est légèrement plus ancien. Il nous vient du Canada et plus précisément des bas-fonds de ce pays, et ce n’est ni plus ni moins qu’une abréviation arbitraire du mot détective. Qu’il résulte de la déformation franco-canadienne d’un mot anglais est une explication possible quoique nullement certaine. Toujours est-il que le mot dick a franchi la frontière du Canada en compagnie de caisses de gnôle lorsque la Prohibition a commencé en 1919. Nous voici donc en possession de ces deux mots, mais ils n’ont jamais encore été utilisés côte à côte.

Certains ont dit qu’en Europe et en Amérique, la Première Guerre mondiale a profondément altéré le tissu social et que nous subissons toujours, à certains égards, les répercussions de cet événement. Bien sûr, l’assurance de l’avant-guerre, la certitude que chacun était à la place qui lui convenait au sein d’une machine sociale bien huilée, cette certitude a bel et bien disparu. Le doute, l’aliénation et ce que je vais appeler l’atomisation ont pris sa place. Par ce terme, je cherche à exprimer l’idée qu’une personne n’est pas rivée à une place spécifique et à un rôle dans la chorégraphie majestueuse que la civilisation dessine, mais que nous sommes tous des atomes instables et séparés les uns des autres. En Amérique, quatre mois seulement se sont écoulés entre la fin de la guerre et le début de la Prohibition, ce qui mérite à mon sens d’être compté au nombre des expérimentations sociales les plus stupides jamais menées depuis la Croisade des enfants. Non content d’engendrer le crime organisé, de prodiguer aux gangs de criminels une vaste source de revenus et d’entraîner de façon mécanique la corruption des policiers, des politiciens et des autres figures d’autorité, la Prohibition a accompli quelque chose de plus grave encore. Elle nous a tous placés du côté du crime en nous incitant à faire des affaires avec lui, à accepter son rejet de la loi et à l’encourager à gagner toujours plus d’argent sans remords.
À l’origine, le roman policier était une sorte d’énigme : qu’on se souvienne de Poe et de tout ce qui s’ensuit. En France, dans la seconde moitié du XIXème siècle, Émile Gaboriau a inventé un détective nommé Monsieur Lecoq et s’est servi de son personnage et des énigmes qu’il cherchait à résoudre afin de commenter et décrire les répercussions du grand traumatisme collectif qui hantait son siècle : la révolution française et l’émigration de l’aristocratie. Il avait le chic, soit dit en passant, pour trouver des titres absolument fabuleux tels que L’argent des autres, L’Affaire Lerouge, La corde au cou.

En Angleterre, un petit peu plus tard, Conan Doyle a fait usage des énigmes pour le seul plaisir d’y avoir recours, comme Poe l’avait fait avant lui et bien d’autres également. Ces praticiens du genre les employèrent dans la mesure de leurs possibilités car il n’y avait plus de grands mystères. Dans le monde ordonné, sûr de lui-même et mesuré de l’avant-guerre, les seuls mystères possibles étaient des mystères de médiocre importance.
Le monde des énigmes
Puisque la Première Guerre mondiale et la prohibition se sont combinées afin de créer une atmosphère dans laquelle le monde des énigmes a été tourneboulé pour devenir quelque chose de nouveau et susceptible de refléter une réalité inconnue, je pense qu’il est justifié de combiner deux mots venus de la guerre et du monde des bootleggers afin de désigner ce phénomène inédit. Les privés durs à cuire. Des gars solides qui s’intéressaient à une forme de justice immédiate et violente inséparable de ce moment particulier de l’histoire, puisqu’il n’y avait plus de vérités sociales ou de contrats sociaux fiables et valables sur le long terme. La détermination marquée pour réinventer de fond en comble les histoires mystérieuses apparaît très clairement dans un traitement nouveau des classes sociales et dans l’entrée en scènes d’individus appartenant à des couches sociales variées. Dans la forme précédente – précédente du point de vue de l’origine quoiqu’elle ne soit nullement révolue, ni alors ni aujourd’hui où elle est au contraire toujours bien présente parmi nous – les détectives aussi bien que les victimes ont tendance à appartenir aux classes sociales supérieures, ou du moins à ne pas venir de couches sociales inférieures à la classe moyenne : on n’y trouve, par exemple, aucun commerçant.

Au contraire, le meurtrier peut parfaitement appartenir à n’importe quelle classe. De manière fréquente, cependant, le meurtrier s’avère être un parvenu, il appartient à une classe bien moins élevée que celle dont il prétend provenir. Je ne donnerai que l’exemple de Lord Peter Wimsey et celui de Philo Vance. Les énigmes tendaient à être assez similaires à des mots croisés, dans la mesure où la solution pouvait dépendre d’un savoir ésotérique lié à des tintements de clochettes, à des vases chinois ou à des cendres de cigarettes turques.
Mais le privé dur à cuir fait son entrée, et tout ce bel univers part en queue de quenouille. Les solutions aux énigmes nécessitent désormais des connaissances qui n’ont plus rien d’ésotérique : il suffit de savoir que les gens sont parfois avides, parfois jaloux, parfois effrayés. Par ses origines, le privé dur à cuire lui-même appartient au mieux à la classe moyenne et plus probablement encore à la classe ouvrière, lui qui n’a jamais poursuivi ses études beaucoup plus loin que le lycée et dont la seule connaissance spéciale consiste à savoir où les corps sont enterrés. En d’autres termes, il fait bien partie de ce monde, ce monde nouveau accablé par le doute, privé de repères et dépourvu de sentiments. Et en ce qui concerne les classes sociales supérieures, celles dont l’on croit d’ordinaire qu’elles ont provoqué la guerre et qu’elles en ont profité – ce qui, soit dit en passant, est loin d’être entièrement faux – elles ne s’en tirent jamais bien dans ce type d’histoires. Lorsque d’aventure elles y jouent un rôle, elles font l’objet de moqueries et inspirent le mépris, on n’y trouve que des pigeons, victimes d’escrocs et de joueurs professionnels, dont les filles sont assez stupides pour s’enfuir au Mexique en compagnie d’anciens prisonniers. Leurs membres s’avèrent même, parfois, être les meurtriers, et leurs motivations sont tout aussi humaines et tortueuses que celles de n’importe qui d’autre.
Après avoir créé ce genre nouveau, la perspective adoptée sur la société s’est manifestée de manière particulièrement claire au sein des histoires elles-mêmes. Leurs premiers auteurs étaient souvent des vétérans des guerres récentes, des hommes appartenant à la classe moyenne qui avaient travaillé de leurs mains par le passé, et ce n’était pas le genre de types à penser que la Prohibition était une idée brillante. Ils avaient fait l’expérience de la violence, ils avaient été mis à l’écart de la société – comme le sont nécessairement tous les écrivains qui vivent de leur plume – et ils avaient mûri leurs opinions sur le monde. Tout cela se retrouve dans leurs histoires. On peut faire confiance aux gangsters jusqu’à un certain point tandis que les dandys stupides sont légion dans les classes supérieures. Les politiciens sont véreux et détestent le héros, à l’exception de rares politicards qui l’apprécient et se font du mouron pour lui. Les femmes et les Ford sont agréables à posséder, mais les choses peuvent tourner mal avec les deux. Un cerveau intuitif et habitué à la vérité sans fard est une bonne chose, mais un cerveau et un flingue sont préférables.
Ce nouveau genre, celui des romans policiers racontant les hauts faits de privés durs à cuire, a vu le jour dans les magazines, dans les fictions dites « pulps », et plus précisément dans l’un d’entre eux qui s’appelait Black Mask.
Né dans une nouvelle, le privé dur à cuire avait plus d’une qualité en sus de ses vertus sociales et historiques : il était laconique. Ce qui le distinguait n’était pas nécessairement un nouvel usage du langage – Mark Twain, pour ne citer que lui, pouvait être laconique également – mais le mélange du style laconique avec le mystère, la diversité sociale et la réalité contemporaine créait quelque chose d’inouï jusqu’alors.
Effets de style
Black Mask faisait partie d’une poignée de magazines qui publiaient des énigmes de la vieille école mais dans lequel le genre nouveau a fini tant bien que mal par se frayer un chemin. Le premier privé dur à cuire semble avoir été – je préfère rester dans le vague sur ce point car l’histoire des premiers magasines pulps est pour le moins incertaine – semble avoir été, disais-je, un type nommé Race Williams, créé par un écrivain répondant au nom de Carroll John Daly. Daly n’était pas un écrivain particulièrement talentueux, et il avait la fâcheuse tendance à s’excuser auprès du lecteur pour l’attitude un peu rustre de son héros, mais dès sa première apparition dans Black Mask, il avait trouvé le ton juste et mis le genre sur les rails. J’en veux pour preuve une réplique dans une histoire de Race Williams : « J’ai mis un genou à terre et j’ai tiré deux fois ». D’accord ? En voici une autre : « J’aimais pas sa gueule et je le lui ai dit ».
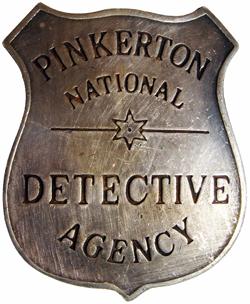
Dashiell Hammett, un ancien combattant atteint de tuberculose – ce qu’on appelait, à cette époque impitoyable, un poumoneux – avait également été détective privé dans l’agence Pinkerton. Il commença à écrire au cours de sa convalescence et Black Mask est devenu son chez lui. Il apporta des améliorations au genre créé par Carroll John Daly de plusieurs manières : d’abord, il ne se donnait pas tant de mal pour jouer les durs et, ensuite, il ne s’excusait pas. Il a également ajouté de l’ironie au genre, ce qui l’a maintenu joliment huilé : sans l’ironie, le privé dur à cuire serait trop vulnérable et trop inflexible pour survivre.
Voici la première phrase d’une histoire d’Hammett publiée dans Black Mask et appelée « La fille de papa » dans laquelle l’ironie, les questions de classes sociales et l’absence de sentiments sont particulièrement mises en relief :
Harvey Gatewood avait laissé des ordres pour que je sois introduit dès mon arrivée, cela me prit donc seulement quinze minutes pour me faufiler entre les portiers, les employés de bureau et les secrétaires qui occupaient tout l’espace entre la porte d’entrée de la Gatewood Lumber Corporation et le bureau du président.
Comparez donc cette phrase, qui manifeste une conscience de classe aigue, avec une entrée classique de Race Williams:
J’ai juste levé mon pied et je l’ai envoyé droit dans la porte. Ensuite, je suis entré dans le hall. Le majordome a mis les voiles, traversant la salle d’un pas maladroit et foulant le plancher en bois verni avant d’atteindre un petit tapis et de poursuivre dessus. C’était rude de ma part ? Bien sûr que c’était rude. Mais si vous devez forcer l’entrée d’une maison, autant le faire de façon déterminée. Que les habitants soient reconnaissants que vous ne vous soyez pas ouvert un chemin à coups de revolver.
Comme vous pouvez le voir, la rudesse est un peu forcée, un peu trop soulignée avant de faire l’objet d’excuses. De plus, les descriptions sont minimales. Tout ce que nous savons au sujet du plancher est qu’il est en bois verni et qu’un petit tapis le recouvre, et encore ne le savons-nous que parce que ces informations permettent de raconter le mouvement de recul du majordome. Si je connaissais ne serait-ce qu’un détail superflu – comme la couleur, le style ou l’origine de ce petit tapis, par exemple – je croirais un peu plus en Race Williams que je ne le fais maintenant1.
Mais cela nous fait dévier de la chronologie. Nous sommes encore au milieu des années 1920, et un nouveau type d’histoire est en gestation, un type spontanément créé par plusieurs écrivains différents à partir des expériences communes qu’ils avaient faites au cours de la précédente décennie. Et lorsque le Capitaine Joseph M. Shaw – il fut nommé capitaine durant la guerre et conserva son grade dans le civil – lorsque le Capitaine Shaw prit la direction de Black Mask en commençant par le numéro de novembre 1926, il devint le premier éditeur dans le monde entier à faire de ce nouveau genre le sujet même du magasine. Lui-même n’était nullement laconique ou violent dans ses écrits, mais il savait reconnaître la vitalité lorsqu’il la voyait. Pour citer ces mots, écrits vingt ans plus tard :
Nous venions de revenir d’un séjour de cinq ans à l’étranger au cours de la remière Guerre mondiale et au lendemain de cette dernière. Tombant par hasard sur un magasine sportif, auquel nous avions contribué de loin en loin au cours des années précédentes, nous fûmes assez curieux pour enquêter sur le changement remarquable qui s’était produit tant dans son format que dans son apparence.
Vous voyez le style. Plus loin, il déclare :
Au cours d’une conversation amicale, on nous demanda de devenir l’éditeur d’un autre magazne appartenant au même groupe : Black Mask, un magasine consacré aux histoires policières. Nous n’avions jamais vu auparavant un seul exemplaire de ce magazine ni même entendu parler de lui.
Le Capitaine Shaw n’en fut pas arrêté pour autant. Plus loin encore, il annonce :
Nous avons consacré nos méditations au sujet suivant : serait-il possible de créer un nouveau type d’histoires policières, distinct de celui attribué aux Chaldéens et plus récemment repris par Gaboriau, Poe et Conan Doyle ?
J’adore cette référence aux Chaldéens. Un peu plus loin encore, le Capitaine Shaw déclare qu’il a étudié l’œuvre des écrivains qui contribuaient déjà au magazine, et qu’il a découvert ainsi Dashiell Hammett : « Il racontait ses histoires avec une force de conviction et une authenticité inédites ». Avec Hammett ouvrant le chemin, un bataillon entier d’écrivains se constitua et en vint à se dévouer entièrement – tâche pour laquelle ils se montrèrent singulièrement doués – aux histoires racontant les hauts-faits de privés durs à cuire.
La plupart des contemporains de Hammett sont à présent aussi oubliés que Carroll John Daly et dans certains cas, c’est tout à fait regrettable. Lester Dent, par exemple, était un tel maître dans l’art de la brièveté, dans celui de délivrer des volumes d’informations au moyen d’un seul mot inattendu dans une phrase, que son œuvre, par sa simplicité et sa fluidité, rappellerait presque un ballet. Voici le début d’une histoire intitulée « Sail », introduisant son héros, un privé dur à cuire répondant au nom d’Oscar Sail :
Le poisson agita sa queue et le couteau détacha sa tête. Un sang écarlate s’enfuit des deux morceaux et se répandit suffisamment pour recouvrir les marques rouges, encore humides, là où deux mains humaines n’avaient pu se maintenir au rebord du quai.
Oscar Sail plongea sa propre main gauche dans la flaque. Le petit policier continuait à sortir régulièrement sur le quai, marchant d’un pas pesant derrière le faisceau lumineux de sa torche électrique.
Sail coupa le ventre du poisson, le jeta par dessus le quai où le yacht était amarré et il y eut des petits remous dans l’eau en dessous de lui. Les entrailles du poisson agrandissaient encore la tache rouge à la surface des flots.
Il y a du talent et de l’intelligence dans cette écriture et quelque chose de plus encore.
Ces gens ont découvert un nouveau jouet, un jouet flambant neuf. Ils s’amusent. Un écrivain nommé Forrest Rosaire, dans une histoire du Black Mack nommée « Le costume du Diable », a essayé de jouer avec au présent. À une époque où Damon Runyon s’était approprié le présent et l’avait utilisé pour créer une sorte de musique de chambre, artificielle et prétentieuse, Rosaire a eu l’audace de le rendre familier, insensible et désinvolte. L’histoire commence ainsi :
Et voici une nuit à L.A où Steve Parker et moi nous rentrons à la maison après un petit match avec les potes. Sur Los Feliz Boulevard, Steeve voit le panneau de Barr’s Café et arrête la voiture en disant : « Ça te dirait, un steak ? ».
Un petit peu plus tard, il y a une bataille de rue en face du café et l’énergie et le plaisir manifestés par l’écriture rappelle les sentiments que l’on éprouve en regardant des gamins jouer au basket. Écoutez donc :
J’imagine que ça aurait mieux valu de lui tourner autour en le frappant du gauche avant de l’exploser avec le droit parce qu’il engage aussitôt la conversation avec un coup du gauche que je parviens tout juste à éviter en reculant. Autour de la pelouse il y a un fil de fer contre lequel je suis propulsé, avant de tomber à la renverse et de heurter le bas de ma nuque. Le type me saute dessus comme il a sauté sur le chien. J’attrape l’intérieur de son manteau, arrache la poche et sent bientôt quelque chose qui me fait l’effet d’une fusée éclairante lorsqu’elle explose sous mon œil gauche. La première chose que j’ai sous la main ensuite est la boite, que je lance au hasard ; le type est debout devant moi à présent et je le vois qui lève son pied pour me frapper en plein milieu du visage. Je le vois, je le répète, qui lève son pied; et après ça, comme dit Shakespeare, c’est le silence.
Rien ne demeure jamais à l’identique – comme mon tour de taille ne cesse de me le rappeler. La vitalité d’un genre nouveau résulte en partie de sa nouveauté elle-même. À mesure que le temps passe, la nouveauté doit nécessairement se faner et alors le genre lui-même doit soit disparaître, soit trouver une autre source de vitalité, un aliment ayant une origine différente. J’aimerais suggérer que, dans le domaine de la fiction populaire, lorsqu’un genre nouveau commence à se faire vieux, la vitalité nécessaire à sa survie provient d’un rituel avant que ce dernier n’en vienne à devenir une sorte de poison qui va inévitablement le tuer. Ce rituel est semblable à ces poisons qui donnent à la face humaine une apparence de santé épanouie alors qu’ils accomplissent tranquillement leur sombre tâche au sein du corps ; ou bien, de façon plus exacte, à ces substances telles que la strychnine, qui à petites doses sont utiles au corps dont la santé dépérit, mais dont l’usage excessif et prolongé cause inévitablement la mort.

Marshall McLuhan, qui a dit un tas de choses stupides, disait pourtant des choses intéressantes de temps à autres. L’une d’elles est qu’il est impossible de décrire un milieu lorsque vous vous y trouvez. Les milieux ne peuvent être décrits que de l’extérieur. La conséquence que j’en tirerai pour ma part est que nous pouvons décrire notre propre milieu en usant d’inférences, à condition toutefois d’étudier des milieux similaires. Pour en revenir à des questions plus terre à terre, j’aimerais consacrer un bref moment à comparer les histoires de policiers durs à cuire avec le Western. Ces deux formes, bien sûr, s’efforcent de décrire un monde spécifique à l’intention d’un public qui ne le connait que très vaguement mais n’en est pas moins fasciné par lui. Le Western décrivait l’Ouest américain à un lectorat sédentaire. Dans les histoires mettant en scène des détectives durs à cuire, c’est à l’intention de ceux qui vivent dans la partie encore émergée que la société est décrite comme un navire faisant eau de toute part. A contrario, les histoires mystérieuses confirment l’existence et le bien fondé d’une structure sociale partagée faisant l’objet d’un consensus universel. Elle est donc plus similaire aux westerns qu’aux histoires mettant en scène des privés durs à cuire.
Le western comme reportage exagéré
Le western a commencé comme un reportage exagéré. Les romans à quatre sous, les exploits de Buffalo Bill et Wyatt Earp dont les journaux de l’époque se faisaient les échos, étaient plein de mensonges, d’absurdités et de contes à dormir debout, mais il faut bien voir qu’il s’agissait de mensonges proférés par des gens qui savaient la vérité. Les premiers écrivains à pratiquer ce genre avaient été là-bas, dans l’Ouest, sur la frontière et parmi les pionniers, ils avaient fait l’expérience d’une réalité sur laquelle ils pouvaient s’appuyer en racontant les mensonges dont ils savaient qu’ils plairaient à leur audience sur la côte Est. Ils pouvaient même inventer des duels au pistolet, des raids meurtriers lancés par les Indiens, des attaques de grizzlys ; certains allaient jusqu’à inventer des animaux imaginaires mais l’esprit derrière leurs histoires – et la toile de fond de ces dernières – étaient bien réels, vivants et vibrants dans leur esprit. Derrière les mensonges se cachait une vérité à demi consciente et une partie de cette vérité n’était autre que l’amour des auteurs pour les lieux et les gens au sujet desquels ils écrivaient. Ils aimaient jusqu’aux mensonges parce qu’ils faisaient partie du décor – même les mensonges étaient une partie de la vérité.
À mesure que le temps passait, cependant, et que la réalité de l’Ouest lui-même se modifiait, la relation originelle de l’écrivain avec son matériel devait changer également. De nouveaux écrivains se présentèrent, qui n’avaient jamais foulé ce territoire lointain mais qui n’en écrivirent pas moins des histoires.
Clarence E. Mulford, l’auteur de la série Hopalong Cassidy, vécut toute sa vie en Nouvelle-Angleterre et il avait cinquante ans passés la première fois qu’il s’aventura à l’ouest de l’Hudson. Ces écrivains, qui n’étaient jamais allés dans l’Ouest, qui n’avaient jamais vu la vérité de leurs yeux, ne disposaient d’aucun autre matériau pour écrire en dehors de celui qu’ils trouvaient dans les œuvres de leurs prédécesseurs. Leurs inventions ne pouvaient pas résulter de l’expérience des pierres, de la poussière, des sentiers et des arbres du territoire lui-même : elle devait découler de fictions antérieures. Voilà qui nous amène au rituel. Afin d’être bien sûrs de ne pas trop s’écarter de l’acceptable – à savoir, non du réel, mais de ce qui était perçu comme tel – afin de demeurer dans les bornes de ce que le lectorat était disposé à croire, les écrivains devaient lui donner à lire des choses qui avaient déjà été crues auparavant.
Par exemple, dans le Far-West tel qu’il a réellement existé, il est faux que tous les adultes de sexe masculin possédaient une arme de poing, un revolver ; mais parmi ceux qui avaient une arme, moins d’un sur dix possédait également un étui de revolver, accroché en haut de la cuisse droite. La plupart des hommes qui possédaient un revolver, s’ils voulaient le transporter avec eux, le portaient soi dans une poche ou bien le mettaient à leur ceinture. Mais le rituel, pour sa part, imposait non seulement que tous les hommes possèdent un revolver et que tous, sans exception, possèdent également un étui, mais aussi que tous se soient exercés à sortir le premier du second plus vite que leur ombre2
Mais cette sorte de réalité ne parviendra jamais à s’imposer à la place du rituel. Et au fil du temps, le genre devient de plus en plus prévisible et routinier, au point que vous ne pouvez plus être entièrement sûr d’avoir lu ce livre-ci ou non. Pour vous donner un autre exemple, les romans gothiques en format de poche ont fait l’objet, il y a quelques années de cela, d’un engouement considérable. Un éditeur qui publiait des œuvres appartenant à ce domaine m’a dit un jour au sujet d’un livre dont il s’occupait – l’un des quatre romans gothiques qui paraissait chez lui ce mois-là – qu’il était réellement enthousiasmé par cette œuvre parce qu’elle mettait en scène une innovation d’une audace folle : « La fille n’est pas une gouvernante », dit-il « c’est la cuisinière ! ».
Ces romans gothiques étaient dépourvus de toute force en dehors de celle qui leur était conférée par le rituel : ils ont donc rapidement périclité avant de s’éteindre. Le Western avait de la force, il a survécu, il a perduré, et de temps à autre, le rituel lui-même mène au grand art. C’est au roman de Jack Schaefer, Shane, que je pense ici.
D’une réalité exagérée à la possibilité de l’art en passant par une resucée de fiction : voilà l’itinéraire du Western. Dans quelle mesure éclaire-t-il les histoires de privés durs à cuire ?
En premier lieu, aussi bien le Western que les histoires mettant en scène des privés durs à cuire placent au cœur de leur rituel un sujet identique: un homme chevaleresque plongé dans un monde dépourvu de sentiments généreux. Cela ne définit pas exactement le thème principal des romans à quatre sous ou des premiers numéros de Black Mask, mais c’est ce que les rituels ont contribué à imposer. Et, bien sûr, cela nous mène directement à Raymond Chandler.
Hammett était le principal représentant de la première vague : celle des écrivains qui avaient été sur place et qui connaissaient leur matériau à l’état brut. Une décennie plus tard, en 1936, Chandler a commencé à écrire pour Black Mask: c’était un fils à maman, du genre binoclard formé en Angleterre, dont le matériau à l’état brut n’était pas la vérité mais la première décennie de fiction.
Je ne dis pas cela pour dénigrer Chandler, ou du moins je ne le dis pas pour le dénigrer beaucoup. Au fil du temps, la vérité continuait à changer, les écrivains de la première vague étaient eux-mêmes éloignés de leurs origines, la Première Guerre mondiale était enterrée sous les présages inquiétants de la prochaine guerre à venir, la Prohibition était finie et avait laissé place à la Dépression et même les comportements en société subirent un changement supplémentaire. Avec la Dépression, les gens éprouvaient davantage la nécessité de s’entraider et avaient besoin de croire dans la communauté bien plus que dans l’individu isolé. Avec tous ces changements et le passage du temps, la plupart des écrivains de la première vague, Hammett compris, avaient tout simplement leurs batteries à plat. …
A suivre, deuxième partie dans la section Essais et Fictions, D’une guerre l’autre : les privés dans le roman noir américain selon Donald E. Westlake (2)
Donald E. Westlake
Cet article a d’abord été présenté lors d’une conférence donnée à la Smithsonian Institution, le 13 mai 1982.
Traduit de l’anglais (USA) par Benjamin Hoffmann
Notes
| ↑1 | Race Williams n’était pas seulement le premier des privés durs à cuire : il était aussi le modèle d’un type de personnage que l’on retrouve encore dans ce genre. Voici un nouvel exemple de l’attitude bravache de Williams : Les journaux étaient sans cesse en train de me descendre en flammes pour avoir abattu une petite frappe ou de chanter mes louanges parce que je m’attaquais aux grands pontes. Mais quand vous chassez les types au sommet de l’échelle, vous devez écarter – ou bien flinguer – les mercenaires à leur solde. On ne fait pas des hamburgers sans écraser la viande. Cette attitude défensive, cette conscience de la publicité des faits et gestes du héros, cette fierté tirée d’être un excité de la gâchette : aurions-nous à faire au père de Mike Hammer ? |
|---|---|
| ↑2 | Des années après la disparition de ce qu’on a coutume d’appeler le « vieux Far-West », un ancien rescapé de sept fusillades dans des bars – chiffre qui paraîtra modeste dans le domaine du rituel mais n’en est pas moins considérable dans l’existence réelle – décrivit la tactique qu’il avait adoptée pour en réchapper. Il possédait bien un étui de revolver et lorsqu’il voyait que la fusillade était sur le point de commencer, il saisissait son arme et pressait la gâchette. La balle atterrissait dans le sol, bien sûr, mais le but recherché par le tireur consistait uniquement à produire du bruit. Pendant que son adversaire essayait de déterminer s’il venait juste d’être touché ou non par une balle, l’autre sortait tranquillement son revolver et le laissait mort sur le plancher. |