Mai 1968 à Paris fut certainement grisant. « Sous les pavés, la plage », clamait le slogan. Les adeptes du marxisme, léninisme, maoïsme, trotskisme et de peu ou prou toutes les autres idéologies de gauche unirent leurs forces contre le régime archaïque et autoritaire du Général de Gaulle. Des jeunes survoltés occupèrent les universités, dressèrent des barricades et affrontèrent la police dans des batailles épiques qui firent sept morts, tandis que le pays entamait une grève générale qui dura des semaines. Bien que ce niveau de violence ne fût pas louable en soi et que la naïveté de ces idéaux politiques parût quelque peu navrante vu de Prague où la population était déjà autrement plus sensibilisée au potentiel destructeur de ces idéologies, les intentions n’en étaient pas moins relativement nobles. Le mouvement a profondément transformé la société française, passée d’une mentalité conservatrice à une attitude plus ouverte, tolérante et (auto)réflexive1.
Quand la gauche française se confronte aux spectres du passé
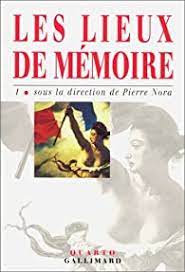
Au lendemain de mai 1968, une diversification idéologique se produisit parmi les jeunes militants d’extrême-gauche, une faction persistant dans sa défense de Mao Tsé-Toung, le Viêt Nam, le Cambodge et autres causes apparentées, tandis que d’autres réorientaient leur activisme dans le domaine de la mémoire historique. Les militants et les universitaires engagés sur cette voie ont par exemple conjointement décrié, dans un rejet délibéré du nationalisme, la réticence officielle qui prévalait alors à reconnaître la complicité de l’État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la perpétration de massacres pendant la période coloniale, en particulier en Algérie. Cet intérêt général pour la mémoire conduisit également à la célèbre série des Lieux de mémoire, dont le premier volume fut publié par Pierre Nora en 1984, et se refléta par exemple dans le film Shoah de Claude Lanzmann en 1985.
En 1990, la première loi mémorielle, initiée par un ministre communiste, Claude Gayssot, ce qui n’était pas un hasard, prohiba la négation des crimes contre l’humanité, en premier lieu de l’Holocauste. La décennie suivante fut marquée par les procès contre d’anciens hauts fonctionnaires du régime de Vichy, Paul Touvier et Maurice Papon, ainsi que par la reconnaissance décisive en 1995 de la culpabilité de l’État français dans la déportation de sa population juive, admettant enfin au niveau de l’État ce qui était consciencieusement enseigné dans les écoles françaises depuis des années, si ce n’est des décennies. Parallèlement, les critiques de la politique des archives régissant l’accès aux documents de la Seconde Guerre mondiale et plaidant en faveur de leur ouverture plus large ont gagné du terrain. En 2001, deux nouvelles lois mémorielles ont été promulguées, soulignant ainsi l’engagement durable de la France à légiférer sur le patrimoine historique et mémoriel de la nation.
Il s’est donc produit en France, pendant plusieurs décennies, un travail délibéré sur le passé, avec confrontation aux spectres historiques et synthèse de l’histoire et de la mémoire en vue de formuler un récit historiographique normatif. Ce qu’il convient de souligner ici est que ce récit a clairement émané de la gauche.
Bien que ce projet collectif ait été empreint de bonnes intentions, certains historiens étaient déjà dans les années 1990 mal à l’aise devant cette rectitude morale. Était-il vraiment nécessaire de promulguer des lois mémorielles pour dicter à la population non seulement ce qu’elle devait dire, mais même ce qu’elle devait penser ? N’eût-il pas été préférable d’enseigner l’histoire avec tout le sérieux nécessaire pour que personne ne songe même à nier l’existence de l’Holocauste ? L’historien Henry Rousso, qui dirigeait à l’époque l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), critiqua particulièrement cette notion de « devoir de mémoire. »

Fait amusant, ce récit ancré à gauche se heurta en 1989 à un contrepoint conservateur avec la thèse sur la « fin de l’histoire » de Francis Fukuyama, qui n’était pas l’affirmation catégorique que beaucoup ont voulu y voir selon laquelle tout événement historique cesserait désormais de se produire, mais plutôt la thèse que l’ascendant idéologique de la démocratie et du capitalisme était dorénavant irréversible. Fukuyama soutenait que même dans les régimes non démocratiques et non capitalistes prévalait un semblant d’adhésion à ces principes, ce qui en faisait le cadre intellectuel et normatif indépassable de l’époque. De fait, ce cadre n’a finalement été mis au défi qu’à partir du 11 septembre 2001. Fukuyama a souvent été tourné en dérision en France à l’époque de son essai, mais il a marqué le début d’une nouvelle ère dans laquelle le capitalisme cessa d’être un gros mot, même à gauche. Au contraire, le monde embrassa avec délectation une nouvelle culture, celle de la consommation de masse. C’est sans doute la raison pour laquelle la gauche renonça progressivement à la lutte pour l’égalité économique, un rêve qui perdait dorénavant toute crédibilité, pour passer aux questions d’identités comme les formulait la théorie critique (critical theory.)
1989 et le tournant paradigmatique de la gauche occidentale
Dans ce contexte, l’effondrement du communisme en Europe centrale en 1989 n’a pas été sans répercussions profondes sur la gauche occidentale. Pour prendre l’exemple de la France et de la République tchèque, la chute du communisme a engendré un tournant paradigmatique qui a vu l’approche historiographique française des questions mémorielles devenir tout à coup pertinentes pour les politiques mémorielles postcommunistes naissantes de la République tchèque, et celles des autres pays d’Europe centrale. La construction de la mémoire, la justice, les impératifs archivistiques, la dynamique de la reconnaissance de la souffrance, l’exigence de faire face aux héritages historiques, la recherche d’un récit national cohérent… tous ces thèmes sont soudain devenus cruciaux à Prague aussi.
En retour, la France a été le théâtre d’un recalibrage intellectuel important de la part d’un certain nombre d’intellectuels, notamment d’historiens, qui se sont retrouvés quelque peu décontenancés par le tour des événements. Auparavant ancrés à gauche, certains se sont retrouvés face à un dilemme intellectuel, d’autant plus s’ils nourrissaient déjà des doutes depuis Budapest (1956), Prague (1968) ou Varsovie (1981.) Avec la crise et la chute du communisme, certains se sont engagés dans une autocritique publique ou privée (comme on leur avait consciencieusement appris à le faire dans leur jeunesse communiste), se transformant peu avant ou peu après 1989 en fervents anticommunistes. Les mémoires du grand historien François Furet son typiques de ce mouvement.

L’une des initiatives les plus marquantes dans ce contexte fut l’entreprise dirigée par Stéphane Courtois, ancien militant maoïste appartenant à la génération de 1968 devenu entre-temps historien, qui aboutit à la publication d’un ouvrage phare : Le livre noir du communisme (1997.) Ce livre prétendait dresser un inventaire exhaustif de la répression communiste à l’échelle mondiale, et est à l’origine de la fameuse affirmation sur les « 100 millions de victimes du communisme. » Avant même sa publication, Courtois, conscient du caractère indéfendable de ce chiffre, l’avait ramené à 80 millions – trop tard, le mythe des « 100 millions de victimes » était déjà gravé dans le marbre international et y est resté malgré son caractère controversé parmi les historiens du communisme eux-mêmes, dont le moindre n’est pas Nicolas Werth, qui avait écrit la partie séminale sur l’Union soviétique dans ce même ouvrage et qui fit publiquement état de sa rupture avec Courtois.
Les chiffres évoluent au même rythme que les idéologies
Les chiffres furent réajustés au fur et à mesure de ce changement de perspective, ainsi le chapitre de Karel Bartošek, un historien franco-tchèque lui-même marqué par de ferventes sympathies staliniennes dans sa jeunesse, qui achevait désormais sa métamorphose et se rallia au récit anticommuniste. Dans le Livre noir du communisme, Bartošek parle de 250 000 « victimes » tchécoslovaques. Ce chiffre est tout à fait incohérent avec le nombre réel de victimes, qui se situe entre 3 000 et 5 000 morts (ce qui constitue, cela va sans dire, 3 à 5 000 morts de trop dans tous les cas.) Mais l’auteur joua en réalité sur l’ambiguïté des termes : comme il ne définit pas ce qu’est une victime, le public présuma qu’il s’agissait de « morts », alors qu’il n’était question que des personnes condamnées sur la base de la loi 231/1948, dont plus de la moitié étaient des amendes et non pas des exécutions ou même des peines de prison – ce qui n’exclut nullement respect et compassion pour ces personnes en tout état de cause.
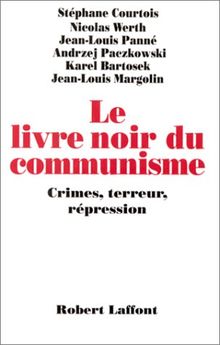
La différence d’échelle avec l’occupation nazie de la Tchécoslovaquie, qui a causé 360 000 morts, est d’au moins 1 à 50, peut-être plus proche de 1 à 100. Grossir les chiffres de la répression communiste comme l’a fait le Livre noir est d’autant plus critiquable intellectuellement qu’il n’était nullement nécessaire de le faire pour analyser de façon convaincante la dimension intrinsèquement répressive du communisme. Mais lorsque les cercles conservateurs gonflent les chiffres, leur motivation est rarement historique.
Quand le récit français rencontre l’anticommunisme tchèque
Entrent ici en confluence et en interaction inattendues une culture de la mémoire et de la repentance issue de la gauche et caractérisée par un « devoir de mémoire » prononcé, et un récit anticommuniste émergent. Le transfert de ce schéma narratif a été effectué pour l’essentiel par des chercheurs familiers des deux rives du fossé culturel (Stéphane Courtois, Karel Bartošek) grâce au fait qu’ils sont eux-mêmes passés de l’extrême-gauche en Europe occidentale2 à la droite ou à l’anticommunisme rageur de l’Europe centrale postcommuniste, et qu’ils connaissaient bien à la fois le contexte français et le contexte communiste et postcommuniste. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’ils ont transposé la forme bien-pensante du récit, mais en ont inversé le contenu.
Alors que cette mémoire historique et ce réalignement idéologique étaient négociés dans les sphères intellectuelles après 1989, une préoccupation sans doute plus importante fit son apparition dans l’Europe centrale en transition, sous la forme de réformes économiques qui causèrent un appauvrissement de masse de la population et la montée en flèche des inégalités économiques. En République tchèque, une décennie à peine après la Révolution de velours, la réémergence du parti social-démocrate (ČSSD) et même du parti communiste (KSČM) a coïncidé avec un mécontentement populaire stimulé par la crise économique et par la corruption croissante et manifeste des élites politiques post-communistes. La pression considérable exercée par l’opinion publique sur la droite conservatrice conduisit à la démission en 1997 de Václav Klaus du poste de Premier ministre qu’il occupait depuis 1992. Dans ce contexte, le Livre noir du communisme est pour ainsi dire tombé du ciel pour les conservateurs tchèques (ODS) et est devenu un outil politique essentiel. A point nommé, le livre proposait un récit propice à la mise en accusation de la gauche passée et présente pour tous les problèmes sociétaux postcommunistes, sans se soucier du fait qu’aux termes de ce nouveau récit les souffrances endurées par la population tchèque pendant l’ère communiste étaient magnifiées par plus de cinquante.
C’est ainsi que la politique de la mémoire en Tchéquie et plus généralement en Europe centrale a pris une orientation de plus en plus anticommuniste, étriquée et conservatrice au cours des années 2000. Une certaine ironie est de mise car les élites conservatrices d’Europe centrale n’ont adopté et adapté rien de moins que la structure narrative cosmopolite et moralement vertueuse élaborée à l’origine par la gauche occidentale des années 1970 et 1980 – récit caractérisé par un cadre normatif axé sur la justice et le devoir de mémoire. La mémoire de la Shoah, conçue à l’origine comme une culture des droits de l’homme, était désormais intégrée, dans le contexte de l’espoir et de l’enthousiasme initiaux pour la « nouvelle Europe élargie », dans un récit politiquement instrumentalisé. En d’autres termes, la révolution mémorielle inspirée par des préoccupations normatives sincères, bien que parfois agaçantes, a été politiquement instrumentalisée pour devenir l’outil de la droite anticommuniste, et même de l’extrême-droite en Pologne et en Hongrie.

Pour boucler cette boucle ironique, Laure Neumayer a montré que l’adhésion des pays du groupe de Visegrád à l’Union européenne a été l’occasion de tirer parti de l’impératif moral entourant la reconnaissance de l’Holocauste et de la législation sur la mémoire dans une optique anticommuniste. Les pays de Visegrád se sont servis de ce paradigme pour promouvoir une équivalence morale entre le nazisme et le communisme avec, comme cela a été argumenté, un programme latent en Hongrie, en Pologne et en Roumanie de relativisation de l’Holocauste et de remise en cause de son unicité. Certes, ce n’était pas l’intention première dans le cas tchèque – ici, l’objectif était plutôt de relativiser les souffrances et les pertes causées par l’expulsion des Allemands des Sudètes en 1945-46. Mais il ne s’agissait en tout état de cause dans aucun de ces pays de favoriser une prise de conscience collective et de faire face à des impératifs moraux de responsabilité comme cela avait été le cas en France dans les années 1970 et 1980.
Quand le souci mémoriel de l’Occident est détourné
La loi tchèque 405/2000, qui punit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans la négation non seulement de l’Holocauste, mais aussi d’un « génocide communiste » non spécifié, est une illustration parfaite de ce transfert culturel incongru. Aucun universitaire n’a jamais sérieusement soutenu qu’un « génocide communiste » avait eu lieu en Tchécoslovaquie ; l’échelle des victimes est de presque 1 à 100 par rapport au nazisme et, plus pertinemment encore, d’environ 1 à 10 par rapport aux Allemands des Sudètes expulsés.
Il y a eu, bien sûr, au moins deux génocides communistes documentés dans le monde : l’un en Ukraine (Holodomor) et l’autre au Cambodge. Mais il est douteux que le législateur tchèque ait avant tout eu le souci de protéger la mémoire de l’Holodomor et encore moins celle du génocide cambodgien, qui n’intéressent guère les électeurs tchèques : ce qu’il visait était d’entrer dans le club des nations dites tolérantes de l’UE et de promouvoir, en surface, la « grammaire de la réconciliation » qui en était une condition préalable implicite. Le fait qu’il ait employé cette grammaire pour promouvoir un récit de concurrence victimaire avec l’Europe occidentale, au risque de gonfler les chiffres de la répression communiste et de relativiser l’Holocauste, est un bonus historique qui n’était peut-être pas entièrement calculé mais qui s’est avéré remarquablement efficace. Paradoxalement, les tchèques critiques du communisme qui étaient en même temps de fervents gardiens de la mémoire de l’Holocauste, tels que Michael Žantovský et Michal Klíma, se sont retrouvés à promouvoir sans même s’en rendre compte un récit qui relativise potentiellement l’Holocauste.
La mémoire est politique et elle est constamment remodelée par le présent ; l’histoire est également politique, et sa méthodologie est même une zone de conflit ouvert en Tchéquie et dans le reste de l’Europe centrale aujourd’hui – il suffit d’observer le débat autour de l’histoire de la vie quotidienne en tant que méthodologie historique, qui est aussi idéologique que le stalinisme ne l’a jamais été. Les politiques mémorielles transnationales et transculturelles montrent que l’histoire est toujours instrumentalisée : parfois de manière plus méthodologique et réflexive et à des fins louables – réconcilier la société avec elle-même et assurer la paix civile –, le plus souvent cependant avec des motifs politiques moins qu’honorables.
Muriel Blaive

Muriel Blaive, historienne, vit à Vienne. Elle est l’auteur de nombreux articles sur l’Europe centrale, et est actuellement rattachée à l’université de Graz au travers d’un projet de recherche du programme Elise Richter sur la confrontation de la société tchèque à son passé.
Les intertitres sont de la rédaction.
Photo de une : Prague 1968
Notes
| ↑1 | Mes remerciements à Gérard-Daniel Cohen pour ses commentaires critiques. Ce texte est issu d’une présentation au workshop After Critical Theory? organisé à Queen Mary University London par Eric Heinze le 2 février 2024. Merci également à lui. |
|---|---|
| ↑2 | Courtois est un ancien maoïste autodéclaré ; Bartošek a évolué dans le cercle d’extrême gauche de la revue L’alternative à son arrivée en France avant de la reprendre en 1986 et de la transformer en La nouvelle alternative, s’adaptant ainsi à l’effondrement prévisible de l’extrême gauche. |