Notre entretien avec l’auteur de « La justice au cinéma », paru en octobre dernier, l’excellente analyse d’un couple presque aussi vieux que le cinéma.
Contreligne – Thibault de Ravel d’Esclapon, vous montrez de façon très convaincante que le cinéma et la justice entretiennent des relations qui vont bien au-delà des prétoires et des films qui sont directement consacrés aux procès. Quelle distinction faites-vous entre le film de prétoire et ce que vous appelez le film de justice
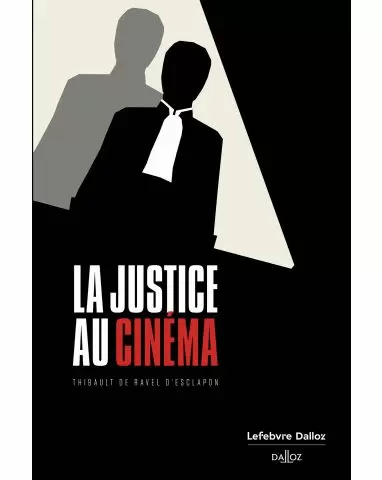
Oui, c’était vraiment l’un de mes souhaits quand j’ai commencé à songer à ce livre, puis à l’écrire. À mon sens, il faut faire une distinction entre le film de prétoire, que les américains appellent le genre « courtroom drama », et le film de justice. Cette distinction est nécessaire ; elle permet d’être plus englobante, en ce sens qu’elle comprend des films passionnants mais qui ne sont pas stricto sensu des films de prétoire. On peut aller au-delà de la seule représentation visuelle de l’audience et s’inscrire tout de même dans le courant justice et cinéma. Ainsi, il y a les films de procès ou encore dit de « prétoire ». Ce sont des films qui tiennent leur intrigue dans le déroulement d’un procès. L’histoire réside dans le procès, dans l’affaire, le case, comme diraient les anglo-saxons. Le dossier est un scénario. L’audience représente les bornes spatiales et temporelles du film. Le tribunal est un décor. Bref, c’est le procès qui fait le film. Bien sûr, ces longs-métrages ne sont pas tous des films-procès, c’est-à-dire des films dans lesquels les audiences tiennent toute la place (c’est le cas, par exemple, du très récent – et excellent – film de Cédric Kahn, Le Procès Goldman). Parfois, comme dans Autopsie d’un meurtre (Otto Preminger, 1959), le procès survient un peu tard, et on voit la phase d’investigation par l’avocat. Certes, ce film est long – cependant, l’on n’a aucunement le temps, de s’ennuyer, tant ce film est exceptionnel à plus d’un titre.
Mais, quand l’audience est au centre et qu’elle devient le sujet du film, on est face à un film de prétoire. Et dans ce genre, que l’on pourrait qualifier d’historique, il y a des classiques absolument magistraux, qui sont de véritables indispensables de la culture judiciaire. Je pense, bien sûr, à Douze hommes en colère (Sidney Lumet, 1957), Témoin à charge (Billy Wilder, 1957), ou encore, en France, à l’exceptionnel et très récent Anatomie d’une chute (Justine Triet, 2023). Tous ces films sont de prétoire, avec, bien sûr, des échappées en dehors de l’audience. La Vérité en offre un exemple (Henri-Georges Clouzot, 1960). Et ils démontrent combien le procès fournit des conditions optimales pour un excellent film.
Mais je ne voulais pas me limiter à cette seule perspective, pourtant déjà très fertile. Je voulais aller plus loin et m’intéresser plus généralement à la représentation cinématographique de la justice. Selon moi, nombreux sont les films qui ne montrent pas un procès mais qui évoquent la justice, par exemple par l’un de ses professionnels, ou en dehors du cadre habituel de l’audience. Pensons, par exemple, à Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000). Il n’y a qu’une courte scène de tribunal (c’est d’ailleurs le juge à la retraite qui joue son propre rôle). Pourtant, c’est bien un film sur la justice, dans un sens plus large. Autre exemple récent : Je verrai toujours vos visages, de Jeanne Herry (2023). Là aussi, ce film dit beaucoup sur l’exercice de la justice, mais sous un angle très spécifique, lequel donne d’ailleurs de passionnants moments de cinéma : la justice restaurative. J’ai revu récemment Le dossier noir, d’André Cayatte (1955). Il n’y a pas de procès, certes, mais quel film sur la justice et son exercice !

Vous indiquez que depuis l’origine du cinéma, le fait divers et sa sanction judiciaire intéressent les producteurs et le grand public.
Oui, c’est un phénomène que j’ai constaté en m’intéressant aux origines de la vingtaine de films que je commente dans le livre. Et peut-être même plus encore que le fait divers, c’est la réalité qui passionne aussi les producteurs, réalisateurs et scénaristes, ce qui, de toutes façons, rejoint le fait divers. Il y a très souvent une « veine réaliste » dans les films de justice, que l’on retrouve dans l’origine du film. Boomerang ! (Elia Kazan, 1948) en est le parfait exemple, quoique sans doute un peu trop, étant donné qu’il s’agit d’un film appartenant au style semidocumentary, un courant cinématographique, dont Louis de Rochemont était l’un des producteurs emblématiques, et qui tendait à fictionnaliser la réalité. Mais La Vérité est aussi l’illustration de ce propos : Clouzot, c’est bien connu, s’est inspiré de l’affaire Pauline Dubuisson. Et puis la veine réaliste se manifeste également à un autre égard : il y a, chez les réalisateurs, un vrai souci de la vraisemblance, une volonté de faire vrai, dans le décor, comme dans l’intrigue. Mais pour revenir au fait divers, oui, c’est un fait
Le film de lanceur d’alerte, dont l’exemple le plus célèbre est Erin Brockovich ces dernières années, et donc autant un film de justice que La Vérité de Clouzot
Je le crois très sincèrement oui. Dans un genre très différent, comme nous venons de l’évoquer. Mais les deux véhiculent un propos sur la justice et, d’une certaine manière, la représentent. Dans La Vérité, les assises sont à l’œuvre. Dans Erin Brockovich, l’on s’intéresse à un mécanisme très important dans l’exercice de la justice, aux États-Unis : le mécanisme de l’action collective. C’est le cœur juridique de la mission que va mener Erin pour obtenir la réparation à laquelle sont en droit de s’attendre, selon elle, les victimes du chrome hexavalent.
A voir la liste des films que vous analysez, on se dit que le système judiciaire des États-Unis est beaucoup plus photogénique et « cinégénique » que le nôtre
C’est quelque chose que l’on peut lire régulièrement. Le cinéma américain offrirait le meilleur du film de prétoire, ce qui serait dû à la nature de sa procédure, de type accusatoire. Ce n’est pas inexact, bien loin de là. Dans le genre, Autopsie d’un meurtre est l’exemple parfait. C’est la nature accusatoire de la procédure (mais aussi la bienveillance du juge) qui permet ces extraordinaires joutes oratoires, ces facéties continuelles de James Stewart – assurément à son meilleur comme acteur. Et c’est sans doute ce qui explique la bonne fortune – mais surtout très précoce – des films de procès aux États-Unis. Les réalisateurs ont vite saisi le potentiel de la procédure accusatoire. D’ailleurs, l’on ne saurait s’étonner que certains réalisateurs français, par le passé, se sont inspiré de la procédure américaine, quand pourtant il s’agit d’un cadre français, avec un décor français. C’est assez évident dans Accusée, levez-vous ! (Maurice Tourneur, 1930). Des auteurs américains ont d’ailleurs analysé ce curieux phénomène de globalisation de la procédure accusatoire.

de Maurice Tourneur (1930)
Après, je ne crois pas qu’il faille trop forcer l’opposition. D’abord, la justice française a donné, par le passé, d’excellents films. On a déjà parlé de La Vérité (Henri-Georges Clouzot, 1960). Mais il y aussi le Septième Juré (Georges Lautner, 1962), ainsi que les films d’André Cayatte, qui sont de grande qualité, même si ceux-ci n’étaient pas du goût de Truffaut. Ensuite, aujourd’hui, il faut noter une floraison de films français de justice, qui montrent bien que notre justice peut facilement être un objet de cinéma. Anatomie d’une chute (Justtine Triet, 2023), Saint-Omer (Alice Diop, 2022), Le Procès Goldman (Cédric Kahn, 2023), L’Hermine (Christian Vincent, 2015) ou encore la Fille au bracelet (Stéphane Demoustier, 2020) et j’en oublie beaucoup. Samuel Theis serait en train de préparer un film de procès. Bref, tous ces films démontrent qu’il y a peut-être, en ce moment, un moment français du film de procès.
Votre analyse du célèbre Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick est intéressante car vous montrez que la procédure de la cour martiale transpose la procédure judiciaire américaine, et pourtant que le film conserve un intérêt proprement juridique et philosophique. Un film peut ne pas rechercher l’exactitude judiciaire sans pour autant cesser d’être passionnant et digne de considération pour les juristes professionnels.
Oui, vous avez entièrement raison, un film peut ne pas rechercher l’exactitude judiciaire sans pour autant cesser d’être passionnant. Certes beaucoup de films de procès recherchent la vraisemblance et l’exactitude. Les réalisateurs se font assister de professionnels du droit ; ils se rendent au tribunal pour essayer de comprendre comment cela fonctionne, pour restituer au mieux l’ambiance et tenter de « coller » à la réalité. Mais certains films font aussi des erreurs. L’exemple du film de Kubrick est très évocateur, me semble-t-il. Le « procès » des trois militaires fourmille d’inexactitudes, si on l’analyse avec une perspective européenne. Mais il n’en demeure pas moins important, voire essentiel. Ces inexactitudes ne sont-elles finalement pas une critique en règle de la « procédure » militaire et de son côté extrêmement expéditif ? Madame porte la culotte (Georges Cukor, 1949) en est aussi un exemple. L’authenticité n’est clairement pas ce que recherchait Cukor. D’ailleurs, d’un point de vue pédagogique, l’exercice est susceptible de se révéler intéressant, permettant ainsi aux étudiants de révéler ce qui n’est pas totalement exact dans la représentation cinématographique du droit et de la justice.
Que pensez-vous des deux derniers films « judiciaires » que nous ayons eus, Le procès Goldman et Anatomie d’une chute, trop récents pour que vous ayez pu les commenter puisque vous terminez par l’excellent Mon Crime de François Ozon
Effectivement, c’est l’un de mes grands regrets que de ne pas avoir pu intégrer Anatomie d’une chute et Le Procès Goldman, qui sont sortis lorsque l’on était au stade des épreuves. Il en va de même du dernier film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Peut-être dans une seconde édition
Comment le cinéma peut-il contribuer à la formation d’une culture juridique pour les étudiants comme pour les professionnels
Les Américains ont développé tout un champ disciplinaire, « Law and Film », à l’image de « Droit et littérature », qui s’intéresse aux rapports entre droit et cinéma. Il s’agit de les théoriser et de réfléchir, notamment sur le plan pédagogique, à ce que peut le cinéma pour le droit. Pour nos étudiants, c’est un formidable moyen, parmi d’autres, d’enseignement. On peut comprendre pourquoi certaines scènes du Verdict (Sidney Lumet, 1982) sont projetées dans les cours de droit de la responsabilité médicale. C’est aussi le moyen de montrer que le droit vit, qu’il est pleinement ancré dans la société actuelle et que la justice est un élément sociétal majeur Pour les professionnels, la représentation cinématographique de la justice est une façon de montrer leur métier. Celui qui veut savoir comment la justice des mineurs se déroule pourrait regarder La Tête haute, d’Emmanuelle Bercot. Puis, plus généralement, la justice dans le cinéma est le moyen de favoriser la critique, de stimuler les interrogations. C’est une chance formidable.

Thibault de Ravel d’Esclapon est maître de conférences à l’Université de Strasbourg
La justice au cinéma, Thibault de Ravel d’Esclapon, Editions Lefebvre Dalloz 2023
Propos recueillis par Stéphan Alamowitch