
Certains philosophes n’abordent jamais les sujets politiques sans conserver ce qui est souvent la faiblesse de leur discipline : le goût des idées absolues, énoncées sans attention pour leurs conditions, leurs nuances et leurs exceptions, le souci de chercher des lois plutôt que d’explorer des situations1… Au lieu de se satisfaire des remarques judicieuses, pénétrantes qu’elle livre parfois dans son essai, Le marché de la vertu Critique de la consommation éthique, la philosophe Estelle Ferrarese croit utile d’en tirer des conclusions profondes, définitives à la lumière d’une économie marxiste dont elle ne connaît visiblement pas grand-chose. Malgré ses références à Adorno, le livre est au fond une œuvre de nature religieuse.
Du juste prix à l’achat responsable
Estelle Ferrarese s’attaque aux pratiques de consommation qui prônent un « juste prix » ou des « achats responsables » dans une démarche critique à l’égard de la pression consumériste qui marque le capitalisme, avec l’ambition de le réformer significativement par le bas, c’est-à-dire par le choix du consommateur. Commençons par les idées les plus intéressantes de cet ouvrage, et qui sont toutes liées aux vraies ambigüités de la consommation éthique.
Comme elle l’écrit justement, ces comportements « visent à injecter des normes, des règles ou des gestes moraux dans les échanges marchands, posés comme en étant vidés par le capitalisme contemporain. ». Elle repère tout aussi justement que ces pratiques notent une intention éthique et un souci des autres transposés dans l’acte de consommation. Ce souci moral conduit le consommateur à se préoccuper du tort qu’il pourrait causer à ces éléments de la chaîne de production et de distribution que le jeu spontané du marché condamne à un sort peu enviable, funeste. Il peut s’agir des ouvriers qui fabriquent les marchandises, des agriculteurs soumis aux agro-industries ou des animaux que l’élevage industriel traitent en choses destinées à la transformation2. Le but est d’injecter de la morale dans un capitalisme dont le mécanisme central, le marché, serait en lui-même dépourvu, puisque dans la tradition de Karl Polanyi, le capitalisme se serait désencastré des normes sociales qui ne procèdent pas de lui.
Que ces comportements de consommateurs soient louables à beaucoup d’égards est certain, Estelle Ferrarese le reconnait, mais pour elle, c’est manquer le point critique : à leur façon, ils reconduisent l’absolutisme du marché et perpétuent le capitalisme et ses lois. L’observation est intéressante, et comporte une part de vérité même si l’auteur ne sait pas la mettre en perspective, cette part.
Passant par l’histoire, l’auteur note que la consommation éthique peut s’autoriser de la doctrine sociale de l’Eglise et de la notion de « juste salaire » de l’encyclique Rerum Novarum de 1891, qui trouve son répondant dans la notion de rémunération équitable et satisfaisante de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Elle relève aussi de façon plus originale que la consommation éthique peut s’autoriser des coopératives de consommation qui ont joué un grand rôle à partir du milieu du XIXème siècle en Europe, par lesquelles les ouvriers, dans un cadre associatif, essayaient de répondre collectivement aux besoins de la vie quotidienne mieux que ne le ferait le marché. La consommation éthique, dès cette époque, veut corriger un système économique dont le fonctionnement mécanique et anonyme peut déboucher sur un prix de spoliation pour ceux qui créent la valeur.

Estelle Ferrarese pointe que le juste prix témoigne aussi d’une façon différente de computer le temps : le juste prix va essayer de rémunérer un temps que le marché ne reconnaît pas et ne rémunère pas, alors qu’il est essentiel à la production de valeur par les producteurs, c’est à dire dans cette optique par les ouvriers qui mobilisent leur travail. Ce juste prix n’est pas la rencontre de l’offre et de la demande, mais procède d’une délibération, en considération du statut social qu’il faut reconnaître aux partenaires de l’échange, sur le temps et sur la parité à prendre comme mesure des prestations respectives. Citant les travaux de Serge Latouche et les réflexions d’Aristote dans l’Ethique à Nicomaque, elle note finement que la consommation éthique veut corriger les imperfections de la justice distributive par le recours à la justice commutative, ce qui est bien vu.
Mais pour elle, c’est aussi admettre implicitement que sont justifiés la différence dans les rémunérations et le fait que le prix puisse légitimement résulter d’un marché sur lequel s’opère la captation de la plus-value. C’est aussi garder, au centre de l’économie, un marché qui ne fait pas disparaître ce que les économistes, mais non l’auteur, appellent les externalités négatives. Ce juste prix admet que tout peut se mesurer et s’échanger, et veut simplement modifier les termes de l’échange marchand. L’auteur considère ainsi que le marché effectue « une réduction des choses de la nature, des êtres humains à un ensemble de paramètres permettant leur valorisation et leur échange », au travers de la monnaie et que la monétisation de tous les aspects de la vie humaine, la quantification de tout aux fins de calculer un juste prix sont une forme nouvelle de soumission à la loi du marché. « Ce qui est perdu, c’est l’unicité, la singularité des choses, des êtres, des milieux, des situations », comme le déplorait l’Ecole de Francfort, dit-elle.
C’est aussi croire, dit-elle, que l’on peut résoudre la crise écologique par des mécanismes de marché, i.e. le marché des droits d’émission carbone ; ce que l’on obtient seulement, c’est que la quantité devient le mode d’existence de la Nature, au détriment de l’expérience vécue des êtres humains. « Empreinte écologique, empreinte carbone, empreinte eau, empreinte matérielle, voilà autant d’indicateurs visant à mesurer les variations d’une grandeur qui est elle-même l’agrégation de grandeurs élémentaires. L’empreinte écologique est ainsi devenue un indice synthétique de soutenabilité écologique, mesurant la capacité régénérative de la biosphère mais permettant aussi tous les calculs de destruction, cette fois-ci au nom du souci éthique. » Ces méthodes, dit-elle, ont aussi l’inconvénient ou plutôt le vice de faire du consommateur le responsable de l’état du monde, ces consommateurs auxquels on fait croire que l’acte d’achat individuel est une solution à la mesure de la question collective. L’observation a sa part de vérité, là encore.
Or, la consommation éthique, sans le reconnaître toujours, refuse qu’il existe de l’incommensurable, et croit tout régler par une quantification corrective dans l’échange marchand. Les « pratiques contemporaines de la consommation éthique et les discours qui les accompagnent découpent sur cette base un régime d’allocation de la légitimité et de l’illégitimité des choix (…). Tout ceci dessine une économie de l’attention, qui crée et rappelle ce qui importe et qui laisse ou rappelle d’autres actes, d’autres torts, d’autres vulnérabilités à l’arrière-plan ». Ceci ne va pas sans arbitraire : Estelle Ferrarese note que le vêtement et la consommation alimentaire sont les domaines de prédilection de la consommation éthique, mais que personne ne se préoccupe des conditions de production des biens culturels, ou des conditions de la consommation de musique en streaming et de la consommation d’énergie particulière qu’elle requiert.
Plus encore, note-t-elle, la consommation éthique, qui se préoccupe du temps non rémunéré ou non suffisamment rémunéré des producteurs, ne se préoccupe pas du temps et du statut des évincés du marché du travail, les chômeurs. Comme elle pense que le chômage procède d’un choix du capitalisme de laisser hors travail certaines populations3, cet oubli lui paraît relever de la complicité !
Estelle Ferrarese met aussi en cause la notion d’authenticité qui est sous-jacente à la consommation éthique. Celle-ci accorde beaucoup de prix à l’authenticité de l’échange marchand, ce qui va au-delà de son équilibre, et qui conduit à s’interroger sur la provenance de la marchandise et sur le producteur auquel on la doit. L’achat auprès d’un petit producteur est censé mettre le consommateur en présence d’une personne authentique, d’un objet authentique, et lui permettre de « s’approprier un objet au fond duquel est déposée l’authenticité qui a été placée par un certain mode de production, n’aliénant ni la Nature, ni la nature humaine. Le consommateur se réconcilie ainsi avec sa nature propre, pourvu d’un besoin d’expression auquel il s’agit de faire droit ». Pour l’auteur cependant, l’idéal d’authenticité témoigne d’un individualisme hypocrite, psychologisant, et surtout il ne fait pas grand mal au capitalisme : « si consommer éthiquement est une manière de vivre en conformité avec ses lois, cela signifie, ironiquement, que la nature peut être restaurée en ses lois par le marché. C’est in fine lui qui a le pouvoir de rendre – ou de donner – à la Nature son statut de nature. »
De façon parallèle, l’auteur critique la recherche d’une information toujours plus précise sur l’origine des produits et des chaînes de production qui est appelée par la consommation éthique, comme si l’ignorance était la raison pour laquelle trop de consommateurs consommaient de façon non éthique. C’est oublier, dit-elle, que la connaissance recherchée est « taillée à l’aune du marché », ce qui n’est pas plus explicité dans le livre, et surtout que les consommateurs sont souvent des privilégiés qui rejettent toute question hors celle du prix. De toute façon, note-t-elle, la question centrale n’est pas celle du comportement individuel et de sa moralité ; la psychologie individuelle est ici sans pertinence.
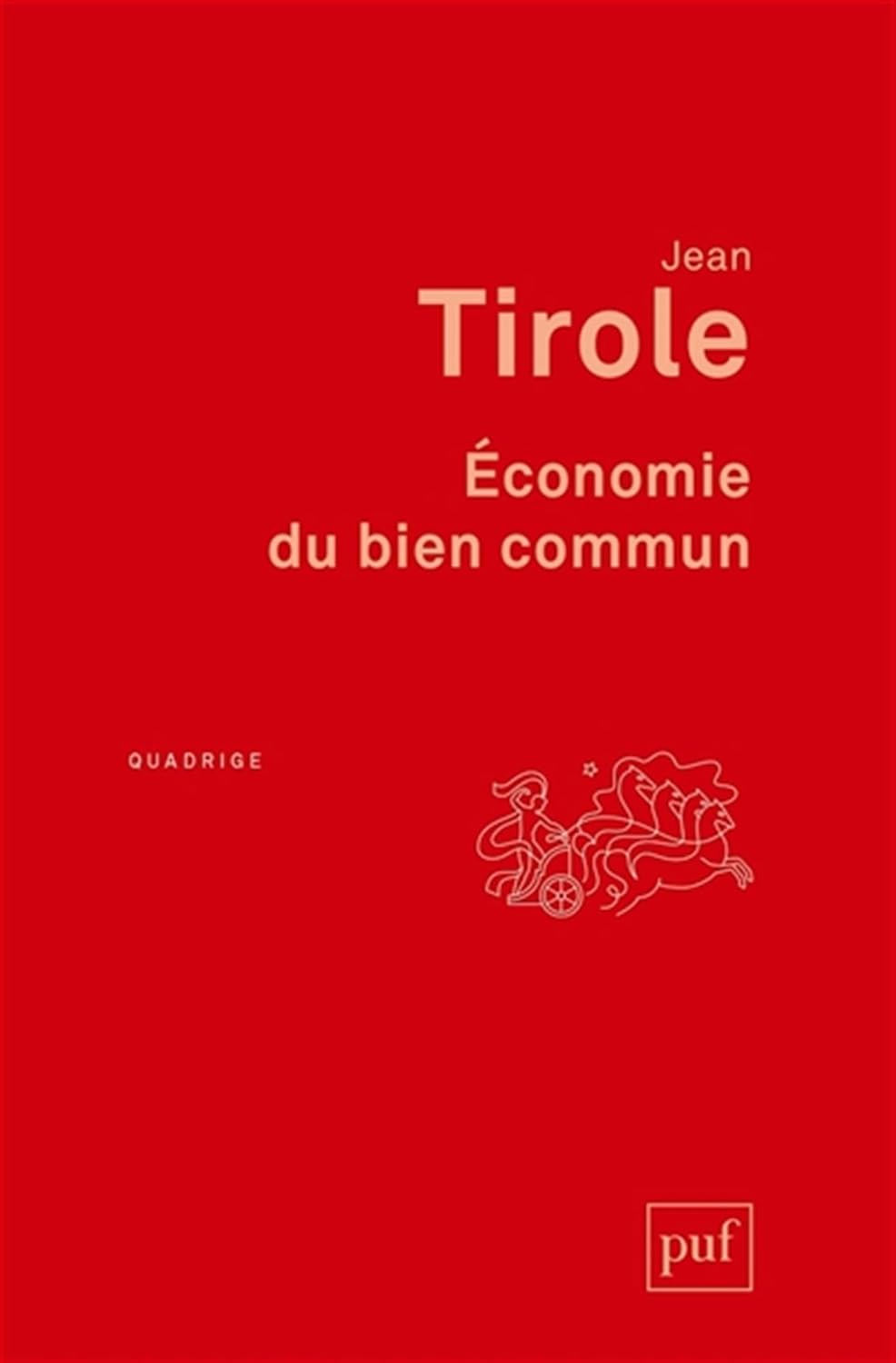
La charge continue quand l’auteur conteste les nouvelles orientations industrielles vers les énergies renouvelables, la décarbonation, le « bio », au motif que cette évolution n’est pas sans coûts cachés qui pourraient annuler les avantages qu’on recherche, à commencer par le surcroît de consommation électrique qui découle de l’usage des nouvelles technologies. Cette contestation peut s’entendre, mais elle n’a de sens que si l’on peut quantifier les avantages et les inconvénients de chaque évolution, et pour cela il faudrait remettre en cause la critique de la quantification héritée de l’Ecole de Francfort.
Il est parfaitement exact que l’idée de résoudre la crise écologique par des mécanismes de marché, des tarifications ou des taxes… a ses racines dans l’économie néo-classique, mais la question ne peut être abordée sans analyse pratique, concrète de ce qui est obtenu par ces mécanismes, dans une démarche empirique – démarche dont il pourrait très bien découler que la solution la plus expédiente n’est pas le recours au marché mais à des réglementations, et à des prohibitions le cas échéant. Ceci est un ordre de réflexion qui ne relève pas de la philosophie, et l’on ne reproche pas à l’auteur de laisser ce débat de côté. Mais pourquoi ne laisse t-elle pas de côté les autres aspects de la réflexion économique et institutionnelle quand elle ne les maîtrise pas ?
Lacunes et point aveugle

On touche là au principal problème du livre : la culture économique de l’auteur est insuffisante, et elle semble se limiter à la théorie de la plus-value chez Marx et à l’analyse de l’impérialisme chez Lénine et Rosa Luxembourg. Même si elle cite certaines œuvres récentes, et notamment celle de Serge Latouche, elle ne connaît visiblement aucune référence économique, même marxiste, sérieuse sur ces questions – rien qui lui permettrait de comprendre que le capitalisme moderne, celui qui se crée au milieu du XXème siècle et qu’on appelle parfois dans la tradition marxiste moderne le « fordisme », ou l’Etat-providence keynésien ou encore aujourd’hui l’économie de l’information ont apporté des éléments très nouveaux qui ne peuvent être ignorés.
Estelle Ferrarese cite cependant Milton Friedman, censé révéler ce qu’est vraiment le capitalisme, mais seulement comme preuve que les théories nouvelles sur la responsabilité sociale des entreprises ne sont que des paravents pour dissimuler l’avidité des actionnaires et la prédation généralisée. C’est oublier que le droit du travail, le droit de la concurrence, le droit de la responsabilité sociale des entreprises sont venus réinjecter de la norme et des institutions dans le fonctionnement spontané du marché, ce que dans leur langage les philosophes allemands qu’elles citent, Axel Onneth et Jurgen Habermas, ont su reconnaitre. Bref, un peu court !
La culture juridique de l’auteur n’est pas meilleure : jamais elle ne parle, dans son analyse de la consommation éthique, des réflexions sur le devoir de vigilance des entreprises qui font que le souci éthique n’est plus simplement dans l’acte d’achat, mais aussi dans la structuration des chaînes de production. Elle ignore aussi visiblement qu’il existe aujourd’hui des normes contraignantes, qu’il ne s’agit plus seulement d’une autorégulation du capital destinée à éviter les interventions de l’Etat quand elles seraient nécessaires. Il y a longtemps que l’on a dépassé le stade de la soft law. Elle écrit ainsi à tort, en citant un ouvrage de 2003, que la responsabilité sociale est le domaine des engagements moraux, c’est-à-dire non sanctionnables juridiquement et qu’il contribuerait par là à minorer le rôle de l’Etat dans la sphère économique (p. 80).
Sur cet arrière-plan d’ignorance, il lui est alors possible de conclure sans nuance que « la consommation éthique fait pire encore qu’échouer en tant que critique du capitalisme, elle collabore à l’ordre même qu’elle s’efforce de corriger. Les pratiques qu’elles rassemblent ne sont pas seulement vaines, elles sont préjudiciables sur le plan économique écologique et social. » ; et assène-t-elle aussi, l’ « apparition de marchandises plus équitables, la multiplication d’offres plus responsables sur le marché débouchent inévitablement sur la prolifération de nouveaux torts portés à la nature, au travail, aux rapports sociaux ». Camarade, ne vous laissez pas détourner de votre devoir révolutionnaire, semble dire Estelle Ferrarese avec un aplomb de communiste vintage. Elle répondra qu’elle s’attache à l’essence du capitalisme, pas à ses modalités particulières…
Et c’est là que l’ouvrage est en fait foncièrement religieux : pour l’auteur, le capitalisme est marqué d’un péché originel qui est l’appropriation de la plus-value au détriment de l’ouvrier, et d’un nouveau péché originel aujourd’hui qui est la destruction de la nature, si bien que les efforts de consommation éthique sont dérisoires. Cette vision la dispense de perspectives historiques et de faits économiques. On ne s’étonne pas que l’auteur finisse par recommander, à la fin de son livre, la lecture d’un ouvrage d’Agamben qui donne en modèle la règle franciscaine de frugalité4, et une vie qui ne soucierait plus de la propriété des choses.
On se permettra de conclure que ce livre sympathique témoigne d’une détestation du marché qui est en réalité une détestation de l’économie et du raisonnement économique. C’est peut-être à l’honneur de son auteur et le signe d’une grande pureté morale, mais ce n’est pas réaliste dans un monde où l’aspiration à consommer, pour les trois-quarts de l’humanité, ne paraît pas faiblir. On se demande enfin pourquoi les éditions Vrin ont publié un livre d’une personne de qualité en ce qui concerne la culture philosophique, mais qui n’a pas les bases ni en économie ni en droit ni probablement en histoire pour les réflexions qu’elle livre aujourd’hui5.
Stéphan Alamowitch
Estelle Ferrarese, Le marché de la vertu Critique de la consommation éthique, Vrin – Problèmes & Controverses 2023
Notes
| ↑1 | Les sociologues au moins se collètent avec la réalité empirique. |
|---|---|
| ↑2 | De façon plus discutable, faute d’avoir mieux observé le mouvement qu’elle critique, elle considère que ce souci se traduit par une abstention plutôt que par des actes positifs. |
| ↑3 | La vieille théorie de l’armée de réserve du capital ! |
| ↑4 | Georgio Agamben, De la très haute pauvreté, Payot, 2013. |
| ↑5 | Pour une critique plus charitable que la nôtre, voir : Alice Le Goff, Revue de métaphysique et de morale, n°121, 2024. |