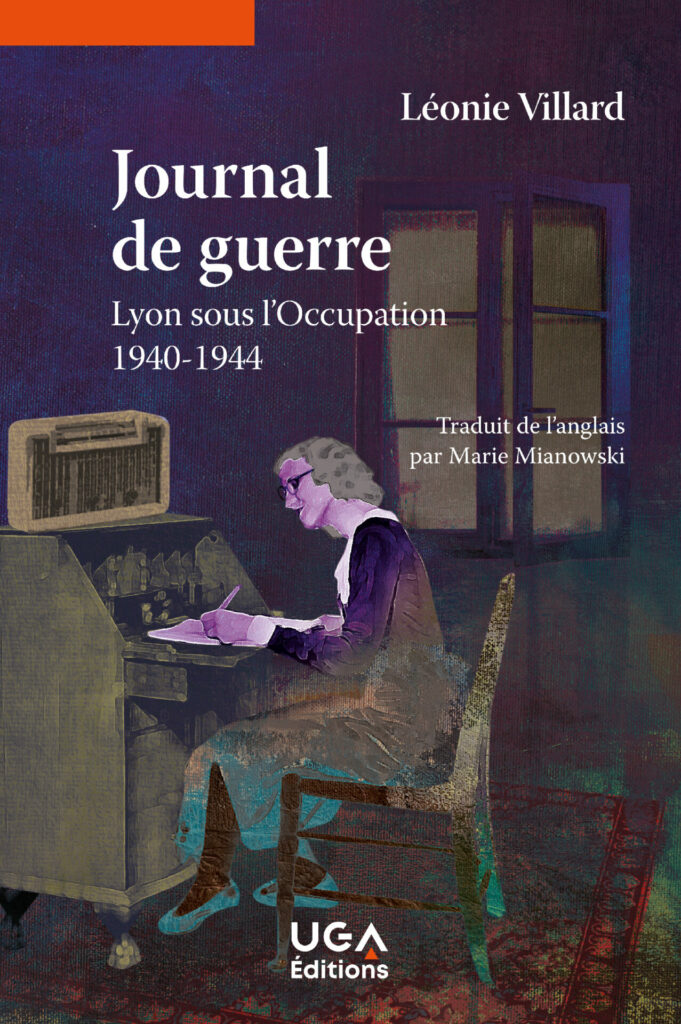
Le début n’est pas prometteur : Léonie Villard, nous dit-on en avant-propos, « semble ne pas exister sur Internet » en 2017 et jusqu’à la création d’une page Wikipedia cinq ans plus tard.
Curieuse conception de la recherche – ou de l’Internet –, alors qu’il est question d’une éminente universitaire française dont quatorze monographies et une préface sont répertoriés depuis longtemps au catalogue numérique de la Bibliothèque nationale de France, à quoi il faut ajouter 61 entrées en tant qu’auteur dans le catalogue WorldCat et pas moins de 218 articles ou extraits de périodiques accessibles sous forme numérisée dans JSTOR depuis 1994. Et c’est précisément l’éminence intellectuelle de la rédactrice de ce Journal de guerre qui en fait le prix. Certes, la carrière de Léonie Villard est résumée à la page suivante et plus longuement, non sans redites, dans une postface qui aurait été mieux placée en préface, mais cette stupéfiante déclaration liminaire laisse une impression d’amateurisme que la lecture de l’ensemble du volume ne parvient pas à dissiper.
Née à Lyon en 1878 dans un milieu relativement modeste, Léonie Villard n’a été reçue bachelière qu’en 1905. Ce retard s’explique par la poliomyélite dont elle a été atteinte ainsi que son frère Léon (plus exactement son demi-frère) et dont les séquelles les suivront pour le restant de leur vie. Reçue première à l’agrégation d’anglais en 1908, elle enseigne au futur lycée Édouard Herriot et en 1915 soutient brillamment en Sorbonne une thèse sur Jane Austen, publiée la même année et précédée en 1914 par une thèse complémentaire, rédigée en anglais, sur l’influence de Keats, son poète préféré, sur Tennyson et Rossetti.

(1878-1970)
Quant à Jane Austen, elle n’était pas encore reconnue en 1915 comme l’un des grands noms, non seulement du roman anglais, mais de la littérature mondiale. Aussi la thèse de Léonie Villard a-t-elle marqué une date, comme l’atteste sa publication en traduction anglaise en 1924 par Routledge (et par Dutton à New York) sous le titre Jane Austen : a French Appreciation ; réédité par Routledge en 2011, l’ouvrage est toujours disponible. Témoignage du prestige acquis par son auteur dans le monde anglophone, il est rendu compte dans le Times Literary Supplement deson livre suivant, La Femme anglaise au XIXe et son évolution, d’après le roman anglais contemporain (1920), le critique anonyme – anonyme comme tous les comptes rendus du TLS jusqu’en 1974 – n’étant autre que Virginia Woolf. Celle-ci ne pouvait qu’être sensible au point de vue féministe clairement exprimé dans l’intitulé des trois parties de l’ouvrage : « Les années de servitude », « Libération de l’énergie féminine », « L’affranchissement sentimental ».
En 1921 Léonie Villard est nommée maître de conférences à l’université de Grenoble, et un an plus tard à Lyon, où, en 1926, elle est la première femme française à occuper une chaire dans une faculté des lettres. On sait par l’hommage que lui rendit son collègue Cyrille Arnavon en 1971 dans la revue Études anglaises qu’elle refusa une offre de la Sorbonne pour rester près de sa mère et de son frère, avec qui elle partageait un bel appartement au 24, rue Tronchet (entre la rue Dugueslin et la rue de Créqui). Malgré son handicap, elle voyage et passe plusieurs mois aux États-Unis en 1928-1929, puis de nouveau en 1931 et 1937, année où Mt Holyoke College, dans le Massachusetts, lui décerne un doctorat honoris causa.
Américaniste
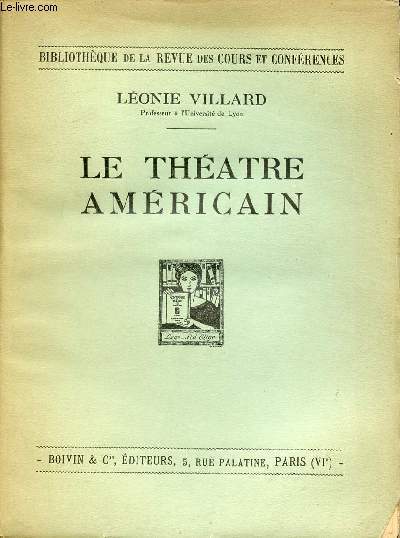
Fascinée par l’Amérique, où elle reçoit le meilleur accueil, Léonie Villard se reconvertit en américaniste et fait de nouveau œuvre de pionnière en publiant chez Boivin en 1929 la première étude parue en France sur le théâtre américain, des origines à 1914 puis de 1914 au milieu des années vingt. Cette brillante synthèse demeure la meilleure introduction que l’on puisse lire à ce sujet. À juste titre, elle accorde une attention particulière à l’œuvre de Eugene O’Neill, « nom qui, maintenant, est celui du premier auteur dramatique de génie qu’aieefnt jamais eu les États-Unis », et auquel est consacré un chapitre entier. La qualité de l’ouvrage est saluée par l’Académie française, qui le couronne d’un prix. Mise à la retraite d’office en octobre 1941 par le régime de Vichy, qui avait abaissé à 50 ans l’âge limite pour les femmes, Léonie Villars n’en continue pas moins à enseigner, et le Journal de guerre donne de nombreuses indications de son dévouement à ses étudiants. Réintégrée dans ses fonctions en octobre 1944, elle conserve sa chaire jusqu’en 1948.
Les voyages aux États-Unis reprennent, et le rythme de publications aussi : deux ouvrages de linguistique, Nouveau lexique français-anglais, anglais-français, avec précis de grammaire et conversation (1944, omis dans la bibliographie de fin de volume) et Essai de psychologie de la langue anglaise (1957), une longue étude historique, La France et les États-Unis, échanges et rencontres, 1524-1800 (1952), et deux études littéraires : La Poésie américaine, trois siècles de poésie lyrique et de poèmes narratifs (1945) et, en complément de sa monographie de 1929, un tout aussi remarquable Panorama du théâtre américain du renouveau, 1915-1962 (1964). En 1946, sa préface à l’édition française de Everybody’s Autobiography de Gertrude Stein, traduit par la baronne d’Aiguy sous le titre Autobiographies, est une lumineuse explication de l’apport de Stein à la modernité littéraire. Son Profils américains, également paru en 1946 (autre omission inexplicable de la bibliographie de l’ouvrage qui nous occupe), n’est pas d’un intérêt moindre, ses six parties traitant de personnages peu connus de la période coloniale (tels le poète Anne Bradstreet et la puritaine dissidente Anne Hutchinson), mais aussi le roman de l’Écossaise Ann Grant, connu pour avoir été lu par Jane Austen, Memoirs of an American Lady, et s’achevant sur les progrès du militantisme féministe américain (« Le chemin qui mène au Capitole »).
Au verso du faux-titre de Profils américains est annoncé un volume joliment intitulé « L’Amérique en fleurs (Collèges féminins en U.S.A.) » et dont on ne peut que regretter qu’il n’ait pas vu le jour. Inédits également sont deux romans dont deux titres (The Old Gods Are Dreaming, La Muraille bleue) sont donnés par Marie-Thérèse Jones-Davies, la plus brillante des étudiantes lyonnaises de Léonie Villard, dans le numéro d’Études anglaises paru en 1971 où est saluée la mémoire de celle qui avait disparu l’année précédente à l’âge de 92 ans.
Tenir son journal sous l’Occupation
Dans ce même article, M.-Th. Jones-Davies cite également de longs extraits du journal de guerre de Léonie Villard, dont elle avait, nous dit-elle, « un exemplaire sous les yeux », ce qui suggère qu’il en existe, ou du moins qu’il en a existé, au moins deux copies. Le même témoignage laisse clairement entendre que ce journal avait été tenu en anglais, peut-être pour des raisons de confidentialité, ou bien parce qu’il était conçu dès le départ à l’intention de lecteurs anglophones, comme certains indices permettent de le penser. La présente traduction a été préparée à partir d’un tapuscrit corrigé confié par Léonie Villard, dans les années soixante nous est-il dit, à une amie américaine, Helen Patch, qui avait dirigé le département de français de Mt Holyoke. Celle-ci est loin d’être une inconnue car c’est elle qui, durant la guerre, avait organisé à Mt Holyoke une reconstitution des fameuses Décades de Pontigny des années vingt et trente autour d’éminents intellectuels exilés, notamment Jean Wahl et Gustave Cohen1. Helen Patch a-t-elle tenté de trouver un éditeur du journal de Léonie Villard en Amérique ? Quoi qu’il en soit, elle a préservé ce tapuscrit corrigé dans ses archives et il est désormais accessible en ligne sur le site de Mt Holyoke2.
Quant au manuscrit originel, ces deux cahiers bleus dont il est question plusieurs fois dans le texte, ils semblent avoir disparu, peut-être détruits par Léonie Villard après la dactylographie3. La collation entre la source originelle et le ou les tapuscrits ayant survécu se révélant impossible, on ne sait dans quelle mesure elle a pu retravailler son texte. Était-ce une simple mise en forme (corrections de langue, développement d’abréviations ou élucidation de passages codés par précaution) ou une véritable réécriture, comme certains passages raturés (p. 20, 23 du tapuscrit) ou ajouts manuscrits (comme p. 52 et 63) pourraient le suggérer ?
Le Journal de guerre commence le 17 juin 1940 et s’achève le 21 septembre 1944, mais il n’est pas absolument continu. L’année 1941 ne comporte que huit entrées, et aucune entre le 7 juillet et le 26 décembre. Pendant ces quatre ans, à part une vaine équipée durant l’exode de juin 1940 dont elle fait le poignant récit, Léonie Villard a partagé son temps entre l’appartement de la rue Tronchet, qu’elle partage avec son frère depuis la mort de leur mère en 1929, et la maison qu’elle a fait construire en 1939 à Oussiat, hameau de Pont-d’Ain, à une soixantaine de kilomètres de Lyon.

Plus d’un lecteur de ce journal se fera la réflexion, à la lecture des entrées de juin 1940, que c’est presque trop beau pour être vrai. Léonie Villard, à qui la personne et la rhétorique de Pétain n’inspirent, dès le départ, aucune sympathie, n’entend-elle pas De Gaulle parler à la BBC dans les cuisines d’un hôtel à Villevocance, à brève distance d’Annonay, où elle et ses compagnons de voyage se retrouvent bloqués ? Toutefois, d’après le contexte, il ne s’agit pas de l’appel du 18 juin, que peu de personnes ont entendu, mais de celui du 19, qui a eu une audience bien plus large, et – sans même évoquer l’intégrité intellectuelle indiscutable de son auteur –, le récit est d’autant plus crédible que l’écoute de la radio anglaise était pour elle une activité habituelle. Et l’on se rend rapidement compte que l’on a ici le témoignage de tout premier ordre d’une personnalité d’une richesse peu commune chez qui l’intellect va de pair avec de grandes qualités de cœur, et dont le talent de narratrice égale la finesse d’observation.
Les difficultés de la vie quotidienne – essentiellement l’alimentation et le chauffage – occupent naturellement une place importante dans ce récit, qui nous permet de mesurer une nouvelle fois combien les années de l’Occupation ont été éprouvantes pour la population, que ce soit en zone occupée ou en zone libre – liberté toute relative et qui prend fin le 11 novembre 1942. Elles sont d’autant plus éprouvantes pour Léonie Villard et son frère qu’ils souffraient d’un handicap. Ces privations ont d’ailleurs raison de la santé de ce dernier, qui meurt le 5 décembre 1942.
Rigueur et patriotisme en temps de guerre
Comme l’a pertinemment observé Isabelle von Bueltzingsloewen, on est frappé à la lecture de ce journal par la rigueur inébranlable de l’attitude de sa rédactrice envers l’Allemagne nazie et par sa foi sereine en la victoire des Alliés, qu’elle s’abstient de critiquer même lorsqu’elle évoque les terribles bombardements de 1943-1944. Ses commentaires dédaigneux sur la propagande de Vichy, l’horreur que lui inspirent les collaborateurs, le mépris cinglant qu’elle exprime à propos de Pierre Laval lorsqu’il souhaite publiquement la victoire de l’Allemagne ne manqueront pas de susciter l’admiration du lecteur, d’autant plus que ces sentiments sont partagés par tous les Lyonnais qu’elle fréquente. Il y a là une extraordinaire leçon de patriotisme au sens le plus élevé du terme, puisqu’il s’incarne chez la dernière personne qu’on pourrait taxer de nationalisme.
Tout en se défendant modestement d’avoir été résistante, Léonie Villard n’en a pas moins contribué à la résistance dans toute la mesure de ses moyens, diffusant les informations entendues à la BBC, protégeant ses étudiants, acceptant de prendre sous sa direction un jeune résistant (Jacques Le Bailly) ayant besoin d’une couverture universitaire, et servant de « boîte aux lettres ». Les risques encourus étaient gros.
Chacun voudra évidemment savoir quel état elle fait des persécutions antisémites menées par l’Occupant avec l’entière complicité du régime de Vichy. Il n’en est question pour la première fois que le 16 septembre 1942 au moment de la protestation des évêques de France contre la rafle des enfants juifs « étrangers » recueillis dans des monastères. C’est en effet à l’été 1942 que l’opinion publique a commencé à basculer dans les milieux catholiques libéraux auxquels Léonie Villard appartenait. Jusque-là, sans que l’on puisse parler d’indifférence, les préoccupations quotidiennes – se nourrir, se vêtir, se chauffer – prenaient le pas sur toute autre considération.
L’épisode qu’elle évoque en septembre 1942 est important, puisque le sauvetage de 108 enfants du camp de Vénissieux est, selon les termes de Valérie Portheret, le « plus grand sauvetage collectif d’enfants juifs opéré dans un camp en France au cours de la Shoah »4. Un autre épisode du journal de Léonie Villard est l’histoire du petit Roger, « adopté » par Lili et Ernest Cursat pour le protéger alors sa mère est traquée par la police ; tragiquement, celle-ci est tuée au cours du bombardement de Vaise en mai 1944. Mais est-il permis de ressentir un léger malaise quand, au moment de l’arrestation d’une ancienne étudiante et sa sœur (les Soucelier, qui ont leur rue à Lyon), Léonie Villard rapporte qu’on a entendu les deux jeunes femmes dire « qu’elles n’étaient pas juives et pouvaient le prouver » et que la famille s’est empressée d’envoyer à la police allemande des certificats d’aryanité ?
Des choix éditoriaux discutables
Proposer en traduction un texte inédit qui n’a pas encore été proprement établi n’allait pas de soi. La responsable du volume, à part de rares commentaires en note, n’a pas cru nécessaire de nous informer de sa méthodologie, peut-être parce qu’il n’y en avait aucune. Peu informée en matière de philologie, elle appelle coquille un lapsus et interprète comme une « coupure » (textuellement inexistante) ce qui, au vu du manuscrit en ligne, ressemble davantage à un raccord entre deux frappes. Si l’on peut admettre certaines corrections tacites (« Villecance » rétabli en Villevocance), encore eût-il fallu en signaler le principe. D’autres sont contestables. Admettons l’inadvertance quand Sottens devient Sotten, mais pourquoi Kharkiv là où l’auteur a écrit Kharkoff, Novorosiïsk à la place de Novo-Rossisk ? Pourquoi Leghorn et non Livourne, Hamburg et non Hambourg ? Grand cas est fait de noms de lieux ou de personnes écrits en capitales (encore fallait-il en tenir compte de manière cohérente et ne pas en ajouter qui n’y sont pas, ou le contraire), mais est-ce significatif puisque la dactylographie n’est pas systématiquement sur ce point, et ne suffisait-il pas d’en faire état ? Aucune attention, en revanche, n’est portée aux mots ou passages biffés et aux variantes potentiellement intéressantes. Quant au mot décrit comme « illisible » p. 275, il est aisément déchiffrable, malgré la surcharge, comme « ennemis ».
Quant à la traduction même, si elle coule aisément, à part les inévitables fautes d’accord, mieux vaut ne pas la confronter à l’original, car – et ceci au vu d’une lecture cursive – elle abonde en calques, en faux-sens (spite traduit par dépit !), en inexactitudes, en à-peu-près, en omissions, voire en contresens. Ainsi, « à moins qu’on ne lui donne plus de nourriture » ne traduit en aucun cas unless he can be given more food ; et ce n’est pas la seule fois où le ne explétif est employé de travers. De même, leaving the church ne veut pas dire « ne plus aller à la messe » ni read the writing on the wall (ajout manuscrit qu’il aurait valu la peine de relever comme tel) « lire ce qui est écrit sur les murs ». Ignorer une expression aussi proverbiale, d’abord n’est pas bon signe, et surtout prouve une fois de plus que la pratique de l’Ancien Testament dans la traduction de 1611 devrait être indispensable à tout angliciste.
Dans au moins un cas, il est pénible de devoir signaler que la désinvolture avec laquelle a été mené le travail d’édition s’accompagne d’une traduction négligente qui aboutit à un effet de censure, intentionnelle ou non. Il s’agit en effet de l’arrestation de l’ancienne étudiante de l’auteur, on the charge of being a Jewess [biffé :] when she was not, qui devient « parce qu’elle était juive », sans mention des mots raturés5. Moins graves, mais symptomatiques d’un manque d’attention aux subtilités de la langue, sont ces « Mr » rendus tantôt par M., comme c’est l’usage, tantôt par « monsieur » en toutes lettres comme dans un faire-part de mariage – et ce style « Noces et Banquets » affecte la postface à un degré pire encore.
Ah, cette postface ! Imaginons pour un instant qu’elle ait été soumise à l’appréciation de Léonie Villard. Elle aurait su trouver les mots, courtois mais fermes, pour expliquer à son auteur qu’en plus de faire double emploi avec la préface, elle cite inutilement de longs passages du texte qui la précède. Elle qui était la modestie même, aux dires de tous ceux qui l’ont connue, l’aurait peut-être encouragée à s’inspirer de son exemple. À coup sûr, elle lui aurait fait comprendre que les deux pages de commentaires personnels goguenards sur le rapport de thèse de 1915 sont totalement déplacés dans un ouvrage sérieux. Et elle aurait su lui expliquer avec tact qu’après avoir estropié à quatre reprises l’orthographe de Libye il est particulièrement mal venu de prétendre débusquer par des « [sic] » des fautes de langue imaginaires chez les autres.
S’il faut se réjouir de la reconnaissance due à Léonie Villard, il est à regretter que son journal de guerre n’ait pas été publié dans sa version originale, avec ou sans traduction en vis-à-vis. On l’a bien fait, et de manière impeccable, pour le journal de Valery Larbaud6 ! Le fait que le tapuscrit corrigé soit accessible en ligne ne rend absolument pas superflue une édition correctement établie et annotée. En attendant, il faudra se contenter de cette version dérivée, quelque imparfaite qu’elle soit, de cet exceptionnel témoignage d’une femme supérieure.
Vincent Giroud
Vincent Giroud, ancien élève de l’École normale supérieure et diplômé d’Oxford, a enseigné dans diverses universités françaises et américaines et a longtemps été conservateur des livres et manuscrits modernes à la bibliothèque Beinecke de l’université Yale
Léonie Villard, Journal de guerre : Lyon sous l’Occupation, 1940-1944, traduit de l’anglais, présenté et annoté par Marie Mianowski, Grenoble, UGA Éditions, 2024 (collection Paroles d’ailleurs).
Notes
| ↑1 | Voir à ce sujet Laurent Jeanpierre, « Pontigny-en-Amérique », dans Artists, Intellectuals, and World War II : The Pontigny Encounters at Mount Holyoke College, 1942-1944, éd. Christopher Benfey et Karen Remmler, Amherst (Mass.), University of Massachusetts Press, 2006, p. 19-36. |
|---|---|
| ↑2 | https://aspace.fivecolleges.edu/repositories/2/resources/178. |
| ↑3 | Voir Isabelle von Bueltzingsloewen, « Les « années noires » de Léonie Villard au quotidien : journal de guerre d’une universitaire lyonnaise (1940‑1944) », Représentations dans le monde anglophone, décembre 2024, accessible en ligne à : https://publications-prairial.fr/representations/index.php?id=1177. |
| ↑4 | Voir Valérie Portheret, Vous n’aurez pas les enfants, Paris, XO Éditions, 2020. |
| ↑5 | Ainsi s’explique probablement qu’Isabelle von Bueltzingsloewen parle carrément dans son article d’« une de ses anciennes étudiantes juives ». |
| ↑6 | Valery Larbaud, Journal, texte établi, préfacé et annoté par Paule Moron, Paris, Gallimard, 2009. |