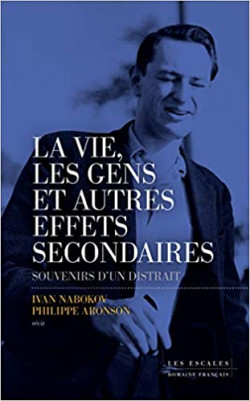Russe de père et de mère – mais, comme souvent chez les Russes de son milieu, avec une bonne part de sang allemand –, le héros de ce livre est issu de deux familles illustres. Fils du compositeur Nicolas Nabokov (1903-1978), cousin germain de l’auteur de Lolita, il appartient à la noblesse libérale riche et éclairée qui en des temps meilleurs aurait pu prendre en mains le destin de la Russie moderne si le putsch bolchevique n’avait pas contraint les siens à fuir, dès 1918, pour échapper à une extermination certaine. Du côté de sa mère, née Schakovskoy, il descend d’une famille princière naturellement plus conservatrice (son oncle a fini comme archevêque orthodoxe de San Francisco) et aux penchants antisémites accusés auxquels il est lui-même resté totalement imperméable. Il est né en 1932 à Kolbsheim, village au sud de Strasbourg, où Alexandre Grunelius, grand ami de son père, et sa femme Antoinette (née Schlumberger) possèdent un château. Son parrain, nous apprend-il au détour d’une phrase, est Felix Bethmann-Hollweg, fils du chancelier de l’Empire.
Lancée en 1928 avec le ballet-cantate Ode, créé par Serge Lifar lors de l’avant-dernière saison des Ballets russes, et confirmée par une symphonie qu’on jouait des deux côtés de l’Atlantique, la carrière de Nicolas Nabokov, le père d’Ivan, semblait bien partie. Mais la mort de Diaghilev en 1929, puis la crise, allaient le contraindre en 1933 à un nouvel exil, américain cette fois, et c’est en Amérique que le petit Ivan grandit, principalement avec sa mère après la séparation de ses parents, et devenant citoyen américain en 1939. Comme il le dit lui-même, né apatride, il se « sent » américain, et même si l’anglais n’est pas sa langue maternelle, il le considère comme « sa » langue. Grâce au soutien de riches amies américaines de sa mère, il étudie dans deux écoles huppées de la Nouvelle-Angleterre (la Fay School et la Brooks School), puis à Harvard, où il se spécialise en littérature anglaise et cultive sa passion pour le théâtre et pour la musique. Son diplôme en poche, Ivan, en 1954, se rend en Europe où il n’a pas mis les pieds depuis 1936.
À Paris, il retrouve son père, marié pour la quatrième fois, et qui est secrétaire général du Congrès pour la liberté de la culture, organisation non gouvernementale issue de l’intelligentsia libérale anticommuniste pour faire pendant à la propagande prosoviétique. Elle est en fait en partie financée, sous couvert de fondations privées, par des fonds du gouvernement fédéral américain transitant par la CIA, mais cela, peu le savent encore même si certains (dont Nabokov) commencent à le soupçonner. Recruté comme attaché de presse par l’Anglo-European Information Service de l’homme d’affaires franco-américain Jimmy Goldsmith, puis comme assistant du producteur de cinéma Norman Krasna, Ivan rencontre, en 1955 celle qui deviendra son épouse : Claude Joxe, dont le père a été ambassadeur en URSS au moment de la mort de Staline avant de devenir secrétaire général du Quai d’Orsay et, plus tard, ministre des Affaires algériennes de De Gaulle, et dont la mère est la fille du fameux historien Daniel Halévy (lui-même fils de Ludovic Halévy, co-librettiste de Carmen et de La Vie parisienne, entre maints autres chefs-d’œuvre). De 1957 à 1963, les jeunes mariés vivent à New York, où Ivan travaille pour la société d’import-export Louis-Dreyfus.
De la Finance à l’Edition
Réinstallé à Paris et à présent père de deux enfants, Ivan s’est retrouvé presque par hasard propulsé dans le monde de l’édition comme représentant de la société d’investissement qui l’emploie au comité de lecture de Robert Laffont. En 1968, il entre au Reader’s Digest, puis, en 1977, chez Albin Michel, comme responsable du domaine étranger. Il y publie des auteurs grand public (Mary Higgins Clark, Stephen King, Tom Clancy, et même Richard Nixon, adulé par le public français) mais aussi de futurs Prix Nobel (en plus d’Elias Canetti) dont le livre contient de courts mais savoureux portraits : Doris Lessing, V.S. Naipaul, et Nadine Gordimer. Quant à Toni Morrison, c’est le refus des éditions Albin Michel de publier Beloved qui pousse Ivan à les quitter en 1988 pour Plon où l’invite Christian Bourgois au nom des Presses de la Cité. C’est là que paraissent, l’année suivante, Les Versets sataniques de Salman Rushdie dont Ivan se demande à présent s’il n’aurait pas été judicieux de le faire lire avant publication par un spécialiste de l’Islam pour savoir en quoi exactement le livre portait injure à la religion musulmane. Mais lorsqu’on se retrouve soudain dans une poudrière, y a-t-il place pour le moindre argument rationnel ?
Si Ivan Nabokov n’a jamais été l’éditeur de son illustre cousin issu de germain, il l’a néanmoins bien connu, et les pages qu’il lui consacre retiendront l’attention de tous ceux qui s’intéressent à celui-ci. Revenant sur la fameuse querelle entre Nabokov et Edmund Wilson à propos de la traduction d’Eugène Onéguine, il conclut – et comment ne pas lui donner raison ? – que tout en ayant fait preuve d’une prétention absurde et impardonnable en s’aventurant sur le terrain de la compréhension du texte original de Pouchkine, Wilson n’en avait pas moins raison sur le fond : ce que Nabokov a produit n’est ni une bonne traduction ni une traduction tout court. Peut-être faut-il voir là un effet de ce qu’Ivan définit judicieusement comme la grande limite de Nabokov, et l’un de ses points communs avec Flaubert : un mépris – pour ses personnages, mais aussi, plus insidieusement, pour ses lecteurs – qui non seulement lui interdit toute empathie mais l’empêche parfois de saisir certaines choses. On trouvera aussi dans le livre des souvenirs de Dimitri, fils de Nabokov et contemporain d’Ivan à Harvard, chez qui pointait déjà un tempérament incertain et autodestructeur.
Portraits de famille
De son propre père, Ivan livre un portrait sans complaisance, d’où ressort, il faut le reconnaître, une figure brillante mais égoïste qui semble avoir considéré les devoirs de la paternité comme une coûteuse corvée dont il n’hésitait pas à s’affranchir sans vergogne. Il est d’autant plus remarquable que le frère cadet d’Ivan, Peter, de mère américaine, soit devenu lui aussi un spécialiste éminent dans son domaine, celui des Indiens d’Amérique.
Peut-être plus terrible encore est l’évocation de Natalie Nabokov, mère affectueuse mais possessive qui n’a cessé de faire pression pour faire rentrer son fils, même après son mariage, dans le giron étouffant de l’église orthodoxe. De sa femme Claude, morte alors que le livre (qui lui est dédié) était en préparation, Ivan présente un portrait affectueux et subtil qui ne manquera pas de toucher ceux et celles qui le liront, même s’ils n’ont pas eu la chance de connaître, comme l’auteur de ces lignes, cette personnalité extraordinairement attachante.
Souffrant depuis sa jeunesse de problèmes d’yeux (dont l’évocation détaillée, dépourvue d’apitoiement sur soi-même, serre le cœur) et aujourd’hui presque complètement aveugle, Ivan Nabokov a trouvé en Philippe Aronson un truchement idéal, qui a su merveilleusement préserver la qualité de la conversation, pleine de verve et d’humour, de celui qu’il fait parler. Ce côté oral, parfois volontiers décousu, et aussi éloigné que possible de toute « pose » autobiographique, donne au livre beaucoup de charme, qu’il soit question du New York d’antan, où les drugstores de Harlem arboraient des pancartes annonçant « Se habla yiddish » ou des grandes personnalités que l’auteur a croisées tout au long de son existence, de George Balanchine à Romain Gary.
Peut-être certains détails auraient-ils dû rester en famille – c’est toujours un point difficile à apprécier.
Quelques lapsus, du genre que l’on commet en conversation, ajoutent presque au naturel du livre : le lecteur rectifiera de lui-même Marc-Aurèle (et non Constantin) comme l’empereur romain dont la statue orne la place du Capitole, et le titre français (au pluriel) de Love’s Labour’s Lost de Shakespeare, dont Nicolas Nabokov a tiré la matière de son second opéra. (Le premier, plus remarquable encore, La Fin de Raspoutine, n’est pas évoqué.) Plus d’un lyricomane s’interrogera sur le mystérieux rôle de Balderi qu’aurait interprété Dimitri Nabokov dans Le Trouvère : par un de ces mystérieux télescopages dont l’Internet a le secret, le nom du personnage (Ferrando) s’est trouvé remplacé par celui de l’interprète (Arcangelo Balderi) lors de la création de l’opéra de Verdi en 1853.
Vincent Giroud
Ivan Nabokov, avec Philippe Aronson. La vie, les gens et autres effets secondaires
Les Escales domaine français, 2021. ISBN 978-2-36569-528-2 (€ 19,90)