
Françoise Rétif, vous vous intéressez depuis longtemps à Ingeborg Bachmann, à sa poésie notamment dont vous avez donné de belles traductions. Comment la présenter au public français qui ne la connaitrait pas, elle qui était poète mais aussi romancière, nouvelliste et même peut-être philosophe, dites-vous dans votre livre ?
Cela fait très longtemps en effet que je travaille sur les écrits d’Ingeborg Bachmann, depuis ma thèse de Doctorat. La première monographie que je lui consacrai, une introduction générale à son œuvre, fut publiée chez Belin, dans la collection « Voix allemandes », en 2008. Je dirais en premier lieu que son activité en tant qu’écrivain ainsi que son œuvre sont difficilement réductibles à un terme ou à un genre. Elle écrivit de tout temps — dès l’enfance ou l’adolescence — des poèmes et des nouvelles ou roman, ce qui est rarement souligné par la critique qui considère, à tort, qu’elle fut poète dans un premier temps, et ne se tourna que plus tard vers la prose. De plus, son exigence de rigueur intellectuelle et de vérité la porta à se tourner vers la philosophie. Après des études de droit, de germanistique et de psychologie (le système universitaire germanophone privilégie l’interdisciplinarité), elle se spécialisa en philosophie et soutint une thèse de Doctorat sur Heidegger, ou plutôt sur « La réception critique de la philosophie existentielle de Martin Heidegger », à Vienne, en 1950. Cette formation en philosophie marqua de son empreinte sa production littéraire et confère à sa pensée, à son œuvre, à sa poésie une profondeur tout à fait exceptionnelle.

Bachmann était donc tout à la fois poète, nouvelliste et romancière, ainsi que philosophe. Des essais radiophoniques sur Wittgenstein ou sur Simone Weil, un discours sur la vérité, par exemple, relèvent de sa production philosophique. Durant les années de jeunesse passées à Vienne, elle écrivit beaucoup pour la radio, notamment des pièces radiophoniques. Elle eut donc également une certaine activité en tant que dramaturge. Sans oublier la production de librettiste en collaboration avec son ami le compositeur Hans-Werner Henze, ni son œuvre de traductrice… La palette de ses talents est très variée ! Ses poèmes se plient parfois à des schémas strophiques et métriques, mais sont le plus souvent écrits en vers libres. Sa prose, quant à elle, est extrêmement lyrique et n’hésite pas à recourir au vers. Cette imbrication entre prose et poésie, entre fiction et essai, entre littérature et philosophie, entre littérature et musique est caractéristique de son œuvre et rend impropre toute catégorisation trop stricte.
C’est pourquoi, dans l’édition et la traduction de ses poèmes, intitulée Toute personne qui tombe a des ailes, que je préparai pour la collection « Poésie » de Gallimard, en 2015, j’insérai un texte en prose qui ne fait partie à l’origine d’aucun recueil et ne se trouve dans aucune autre édition associé à ses poèmes : il s’agit du fragment publié à titre posthume « Le Poème au lecteur » (est-ce le poème ou la poétesse qui apostrophe le lecteur ? l’ambiguïté est inhérente au titre et au texte). Ingeborg Bachmann était une passeuse de frontières, dans son œuvre, comme dans sa vie vagabonde. Elle aimait à souligner qu’elle était née dans une région méridionale frontalière et une ville, Klagenfurt, aux confins de trois pays, l’Autriche, l’Italie et la Slovénie. Et elle mourut à Rome, en 1973, après avoir vécu à Vienne, à Munich, à Naples, à Berlin etc. Dans une interview, elle déclara en outre se considérer comme une « slave »….
Vous consacrez de nombreux passages à sa formation intellectuelle et vous soulignez l’importance de la philosophie. Quel lien avec sa poésie ensuite ?
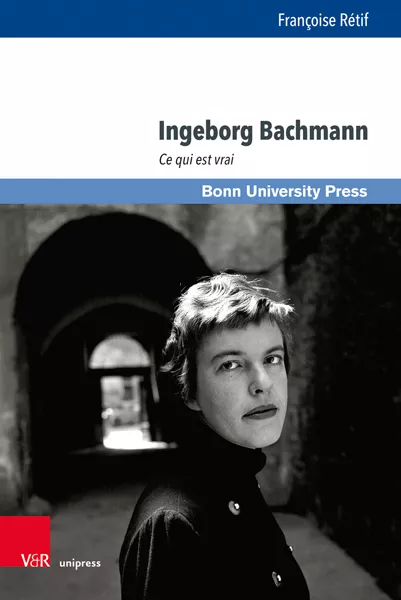
Vous touchez là à une très vaste question, à laquelle il est difficile de répondre en quelques mots. L’essentiel pour aborder son œuvre est de comprendre que l’écrivaine, ancrée dans la tradition philosophique autrichienne de critique du langage, défendit sa vie durant l’idée que « tout est une question de langage ». Pour elle, toute transformation du monde ne peut passer que par la transformation du langage dans et par la poésie et la littérature (qu’elle soit écrite en prose ou en vers). C’est en effet à travers le prisme de la pensée positiviste du Cercle de Vienne et de Wittgenstein, de sa critique du langage et de son refus de la métaphysique, qu’elle prit ses distances par rapport à la philosophie de Heidegger dans sa thèse. Les célèbres aphorismes de Wittgenstein sont connus : « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde » et « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». Tout en adhérant à ces thèses, Bachmann prôna toute sa vie l’idée que les frontières existent pour être transgressées dans et par l’art et elle définit l’individu non pas dans son identité indivisible, mais dans sa capacité à passer de l’un à l’autre côté de la frontière, à « toucher à » l’autre — être ou mot — comme l’illustre son poème préféré, écrit à Prague en 1964 et inspiré du Conte d’hiver de Shakespeare, « La Bohême est au bord de la mer » — un poème qui fait référence aussi bien à Wittgenstein qu’à Heidegger (Cf. le chapitre consacré au poème dans ma biographie de 2008).
Autre exemple : un poème datant du début des années 50, « Comment m’appeler ?», thématise les limites d’un langage incapable d’exprimer les métamorphoses de l’être et sa porosité à toutes les formes du vivant. Le lien entre frontières géographiques et frontières linguistiques, ainsi que la nécessité d’être de part et d’autre, est énoncé par l’écrivaine polyglotte en 1952, dans un fragment autobiographique : « J’ai passé ma jeunesse en Carinthie, dans le Sud de l’Autriche, à la frontière, dans une vallée qui a deux noms, l’un allemand et l’autre slovène. Et la maison, dans laquelle vivaient mes ancêtres, porte aujourd’hui encore un nom qui sonne étranger. Ainsi trouvai-je, à proximité de la frontière, une autre frontière : celle du langage — et j’étais d’un côté et de l’autre chez moi, avec les histoires de bons et mauvais esprits de deux et trois pays ; car par-delà les montagnes, à quelques heures de marche, c’est déjà l’Italie ».
Ce goût pour la transgression des frontières inséparable de la transgression de la stricte identité individuelle au profit d’une existence polyphonique ou d’un moi métamorphique se manifeste sur le plan littéraire par une utilisation des citations intégrées au texte sans guillemets, un emploi qui préfigure la « greffe » derridienne. Ingeborg Bachmann revendiquait cet usage de phrases qu’elle aurait volontiers écrites elle-même en se référant à la musique qui fait souvent usage de variations sur des thèmes de compositeurs antérieurs. Elle y voyait de plus un moyen de donner une seconde vie à une œuvre aimée en l’incorporant à la sienne. Ainsi son roman Malina intègre -t-il des vers de Paul Celan, son amant poète qui mit fin à ses jours alors qu’elle écrivait le texte ; de même, le roman inachevé Franza intègre des vers d’une Saison en enfer de Rimbaud. On pourrait multiplier les exemples de cet usage spécial, fondé philosophiquement, de la citation qui, une fois de plus, transgresse également les frontières entre poésie et prose.
Pour faire bref : selon elle, l’écrivain doit agir sur le monde, et c’est essentiellement en transformant la langue et en refusant le langage imposé, quotidien, celui des slogans, qu’ils soient politiques ou publicitaires (lisez le poème « Réclame » !) — ce qu’elle appelait le « langage des voyous » — qu’il peut le faire.
J’ajouterais que cette critique du langage se reconnut pleinement dans ce que défendait « Le Groupe 47 », ce groupement d’écrivains que créa Hans-Werner Richter en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui voulait refonder la langue allemande en la purifiant de tous les miasmes du national-socialisme. Ce groupe joua dans la vie de Bachmann un rôle essentiel : « découverte » à Vienne par Richter, elle se produisit en mai 1952 devant le groupe et obtint son prix prestigieux en 1953, ce qui la propulsa sur le devant de la scène littéraire.
Elle paraît avoir eu la reconnaissance critique et même une certaine notoriété mondaine dans les années 50-73, date de sa mort. Est-elle encore populaire et encore lue dans le monde germanique ?
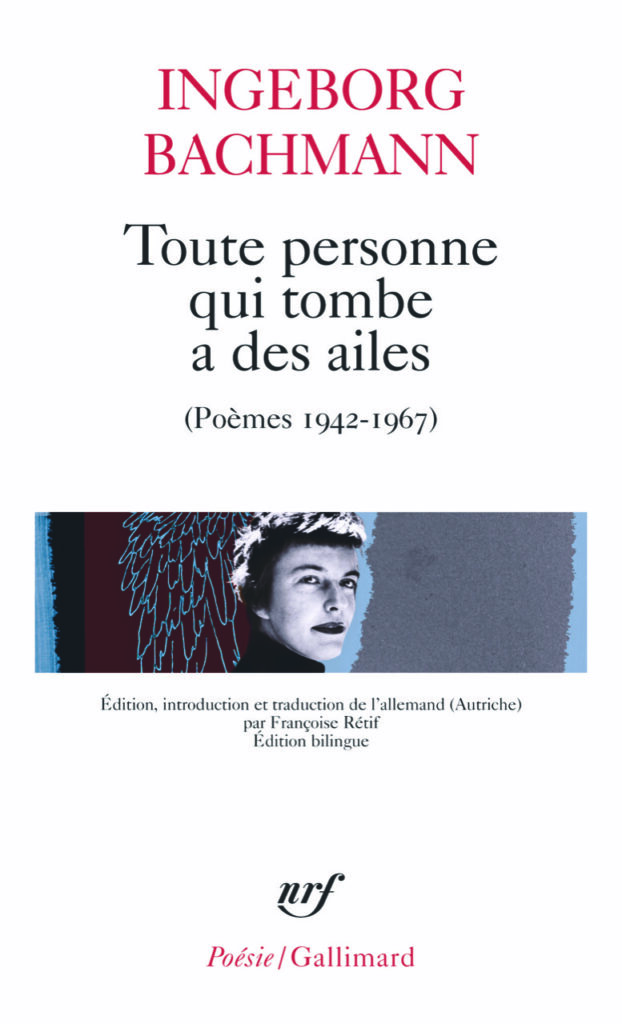
La popularité d’Ingeborg Bachmann est immense dans le monde entier et toujours d’actualité. Elle fut portée aux nues très jeune, en pays germanophone, dès 1953, avec le prix du Groupe 47 et au moment de la publication de son premier recueil de poèmes, Le Temps en sursis. C’est donc en tant que poète qu’elle connut la notoriété, bien qu’elle eût publié auparavant des textes en prose. En août 1954, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel fit sa une avec une photo d’elle signée Herbert List. Une photo remarquable qui sut capter la très grande sensualité ainsi que le regard énigmatique de la jeune poétesse. Cette popularité fut confirmée par la publication du deuxième recueil, trois ans plus tard. Toutefois, après 1956, elle ne publia plus de recueils de poèmes, mais seulement de la prose, La Trentième année, un recueil de nouvelles, en 1961, le roman Malina, en 1971, deux ans avant sa mort, et enfin le deuxième recueil de nouvelles, Simultan (traduit en français sous le titre de Trois sentiers vers le lac), en 1972. C’est sans doute cet ordre chronologique qui explique qu’on entende ou qu’on lise souvent qu’après 1956 Ingeborg Bachmann n’écrivit plus de poèmes. C’est tout à fait faux. Elle continua d’écrire des poèmes, de même qu’elle avait écrit de la prose avant la publication retentissante de ses recueils lyriques. Cependant, ces poèmes plus tardifs ne furent publiés qu’un à un ou par petits groupes, dans des revues, ou bien à titre posthume. Elle n’eut jamais le loisir de les rassembler dans un recueil. Car Ingeborg Bachmann est morte jeune, à 47 ans, d’un accident, et elle laissa derrière elle une œuvre considérable, en grande partie fragmentaire. Un peu comme Kafka…
La critique germanophone, thuriféraire de sa poésie, accueillit assez mal l’œuvre en prose. Ce n’est qu’après sa mort, qu’on lui rendit hommage, en soulignant en particulier sa dimension historique et politique — une dimension qui déplut dans un premier temps en Allemagne, dans l’Allemagne des années 60, à cette époque plus adonnée à la reconstruction qu’à la dénazification. D’ailleurs, l’une des explications de la volonté de l’autrice de publier à partir des années soixante plus de prose que de poésie tient sans doute au fait que cette dimension historique — pourtant déjà présente dans un grand nombre de poèmes, en particulier ceux du premier recueil — avait échappé à la critique. Dans les écrits en prose, il était impossible qu’elle lui échappât… Et cela déplut.
C’est peut-être en France qu’Ingeborg Bachmann est le moins connue. L’Italie la considère comme une écrivaine nationale, comme nous Paul Celan. Pourquoi cette reconnaissance défaillante en France ? Les raisons sont multiples, complexes et en partie irrationnelles. Bachmann tenta pourtant plusieurs fois de s’installer à Paris, mais ne s’y sentit jamais accueillie, jamais chez elle. Après la Seconde Guerre mondiale, la France accueillait plus volontiers les réfugiés, comme Paul Celan, ou les Juifs persécutés, que les enfants de bourreaux… Car Ingeborg Bachmann, l’Autrichienne Ingeborg Bachmann, fut élevée et éduquée dans une famille nationale-socialiste (son père avait rallié très tôt, dès 1932, le parti d’Hitler) et dans une région ultranationaliste, la Carinthie, particulièrement réceptive aux thèses racistes, antisémites, anti-slaves, à tout ce que prônait le parti national-socialiste — sans doute l’une des régions les plus radicalement fascistes d’Autriche. Les enseignants, un corps dont faisait partie Matthias Bachmann, le père, étant les plus ardents défenseurs et propagateurs de cette pensée.
Comment réagit-elle, jeune puis dans son œuvre, quand elle prend la mesure de ce qu’a été la période nazie ?

Ingeborg Bachmann, née en 1926, fut élevée dans l’Autriche nazie, je l’ai dit, par un père lui-même imprégné des idées nationales-socialistes. Pourtant, très jeune, elle témoigne d’une distance radicale par rapport à ce système hégémonique. Cette prise de conscience est relatée dans le Journal de guerre, qui ne fait que quelques pages, mais évoque la vie de la jeune fille de 18 ans dans sa ville natale, Klafenfurt, capitale de la Carinthie, lorsque la ville, à plus de trois cents kilomètres au sud-ouest de Vienne, commença à être lourdement bombardée par les Alliés. Elle était la seule de la famille à vivre encore là, dans la maison familiale. Son père, engagé volontaire dès le début de la guerre, se trouvait sur le front ; sa mère avait rejoint avec la sœur cadette d’Ingeborg, Isolde, née en 1928, et le tout jeune frère Heinz, née en 1939, la petite maison de vacances, héritage paternel, située à une centaine de kilomètres, à Vellach, dans la vallée de la Gail. Ingeborg était restée parce qu’elle devait fréquenter l’Institut de formation des maîtres, institution aux mains d’un professorat majoritairement rallié au national-socialisme. C’était pour elle le seul moyen d’échapper à la formation militaire, service obligatoire, qu’elle aurait dû faire en Pologne pour servir l’Allemagne nazie. Elle avait par ailleurs toujours refusé de rejoindre les jeunesses hitlériennes.
Le prix à payer était lourd cependant : il lui fallut s’engager à renoncer aux études supérieures. Les quelques pages de son journal suffisent à témoigner de sa lucidité, de son courage, de son esprit de résistance. Elle était prête à désobéir et à déserter en face de l’inhumanité et du fanatisme des maîtres ; et elle était prête à renoncer aux études supérieures tant que son pays serait soumis à des valeurs auxquelles elle ne pouvait adhérer. Heureusement pour elle, la guerre prit fin quelques mois plus tard et elle put aller étudier d’abord à Innsbruck, puis à Graz et enfin à Vienne.
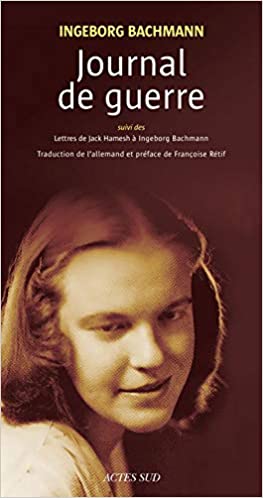
Le journal retrace également son bonheur quand la guerre prit fin, les joies de la libération par l’armée britannique. Il relate la confrontation douloureuse, sous le regard du « libérateur », avec une culpabilité, dont celle qui n’avait que 12 ans en 1938, aurait pourtant pu se sentir exemptée, et la rencontre avec un soldat de l’armée britannique, Jack Hamesh, juif d’origine autrichienne, né à Vienne en 1920, mais qui avait réussi à fuir vers l’Angleterre au dernier moment, en 1938. Cette rencontre fut déterminante pour chacun des deux jeunes gens : lui retrouva pour quelque temps les racines auxquelles il dut si douloureusement renoncer. Elle put enfin s’exprimer, discuter, avec lui, grâce à lui, venu d’un ailleurs de liberté, mais parlant sa langue, de tout ce qui était interdit, de tous les écrivains et philosophes mis à l’index par la dictature nazie, mais dont elle s’était nourrie avec assiduité, malgré l’interdiction, pour rêver d’un autre monde : Rilke, Thomas Mann, Baudelaire etc. Et elle put s’afficher avec lui, « le Juif », encore paria infréquentable pour tous au village. Le printemps 1945 fut pour l’un et l’autre, pour ces deux rescapés des deux extrémités de l’horreur, une sorte de renaissance.
Toute sa vie, Ingeborg Bachmann eut une prédilection pour les ami.e.s et amants juifs, tout en taisant la lourde hérédité qui pesait sur elle. Seul son amant et mentor Hans Weigel, rencontré à Vienne le 5 septembre 1947, fut mis dans la confidence. Les lettres de Ingeborg Bachmann à ce critique de théâtre, essayiste, cabarettiste et romancier d’origine juive, parti en exil en Suisse en mars 1938 et revenu à Vienne dès juillet 45 dans l’intention de réorganiser la scène littéraire viennoise, sont au centre de la deuxième monographie que j’ai écrite sur Bachmann, Ingeborg Bachmann. Ce qui est vrai, publiée en français chez un éditeur allemand, Vandenhoeck et Ruprecht en 2021.
Le déchirement (ou la faille, la fissure, la fente qui l’engloutit à la fin du roman Malina) — ce déchirement entre le passé qui pesait sur elle, dans sa vie personnelle comme dans son appartenance au monde germanique, et la volonté de s’en libérer et de le condamner de la façon la plus radicale est au centre de son œuvre et en constitue le fil rouge.
La guerre et la philosophie jouent un rôle critique dans son œuvre, mais sa vie amoureuse n’est pas sans effet non plus sur ce qu’elle écrit, non ?
On se doutait depuis au moins la parution du roman Malina qu’un traumatisme sexuel avait ravagé la vie de l’enfant ou de la jeune fille. Les lettres à Hans Weigel documentent les séquelles de ce traumatisme et montre combien il ne cesse de hanter la vie de la jeune femme — combien donc, très jeune, elle est déjà atteinte dans sa santé physique et psychique. Quand Weigel se rendit aux États-Unis pour quelques mois, en 1948, elle lui écrivit très souvent et se confia beaucoup à lui, sans restriction ni retenue, comme elle ne le fera jamais plus dans sa vie. Les scientifiques pensaient jusque-là que la maladie d’Ingeborg Bachmann, les crises qui l’ont affectée, les maux qui l’ont amenée à devoir fréquenter les psychologues, psychiatres et hôpitaux au début des années soixante étaient dus à la rupture avec son amant suisse, le célèbre romancier et dramaturge Max Frisch. Mon étude prouve que les maux ne sont pas apparus brusquement après la rupture avec l’écrivain. Et que la jeune femme vivant à Vienne entre 1947 et 1953 cherchait déjà à comprendre le mal qui la tourmentait et souffrait de ne pouvoir se l’expliquer. Car le traumatisme hante d’autant plus le psychisme qu’il est indicible, parce qu’il échappe à la mémoire du sujet. Les violences sexuelles engendrent en effet une mémoire traumatique. Cette mémoire traumatique se trouve au centre de la vie de Bachmann et de son œuvre. Pour dire les choses autrement, l’œuvre est placée sous le signe du dévoilement problématique d’une vérité indicible.

Cependant, il ne faudrait pas croire que le traumatisme subi et ses séquelles ne soient traitées qu’au niveau individuel, biographique. Ce qui est remarquable, c’est qu’au contraire Bachmann lui confère une dimension historique et politique. Il devient emblématique du « fascisme » qui gouvernent les relations humaines et sociales, emblématique du pouvoir abusif d’une ou de plusieurs personnes sur d’autres, sous toutes les formes qu’il peut prendre, dans les différentes institutions qu’incarne le Père dans le roman Malina : pouvoir politique, religieux, culturel, et bien sûr également au niveau familial, privé. Le second chapitre du roman publié deux ans avant sa mort, s’il s’inspire de rêves biographiques, évoqués déjà dans les lettres de jeunesse à Hans Weigel, leur confère une dimension politique et historique qui dépasse largement la dimension psychologique et personnelle par ailleurs également présente. Le Moi maltraité, torturé, violé, enfermé dans une chambre à gaz apparaît comme la personnification de la victime, de toutes les victimes des différentes formes de pouvoir totalitaire que représente le Père dans ses différents travestissements. Les rêves et la vie personnelle prennent une dimension socio-historique, éthique et universelle. « Écrire ne peut avoir lieu en dehors de la situation historique », affirme Bachmann dans les Leçons de Francfort. Pour elle, le fascisme ne cessa pas de sévir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « La guerre n’est plus déclarée, mais poursuivie » (Cf. le poème « Tous les jours »). Une phrase malheureusement toujours d’actualité…

C’est probablement un pont-aux-ânes, mais pourriez-vous nous dire un mot de ses rapports avec Paul Celan, l’autre grand poète allemand cette période, plus connu en France ? On dirait, à vous lire, qu’ils sont intellectuellement et humainement indissociables, tels deux jumeaux ?
Certains critiques ont reproché à Bachmann, fille de nazi, de s’identifier aux Juifs dans ce qu’ils ont subi de pire du temps de la dictature hitlérienne. Je disais qu’elle les fréquenta avec une prédilection certaine, sans doute dans la volonté de « réparer » la faute, d’une certaine façon, ou d’alléger le sentiment de culpabilité. Cependant, je pense que ces fréquentations revêtaient pour elle une portée encore plus profonde : en tant que victime, elle se sentait très proche d’eux. Elle comprenait dans l’intimité de sa chair la douleur extrême non seulement d’avoir subi ce qu’ils subirent, mais aussi de ne savoir comment le dire, avec quels mots. Paul Celan, fils de parents assassinés dans un camp de concentration, démantela la langue des bourreaux pour tenter d’exprimer l’indicible. Il souffrait lui aussi de stress post-traumatique. Par-delà la passion qui les lia, ils étaient en tant que poètes aux prises avec cette vérité indicible qui les hantait. Non, je ne dirais pas qu’ils étaient tels deux jumeaux : leur origine les séparait radicalement. Mais l’amour, la passion des mots et de la littérature, la quête de conscience, de lucidité et de vérité, la confrontation avec l’indicible, ainsi que la conviction qu’« On peut exiger de l’homme la vérité » — tout cela fut plus fort que les origines qui les séparaient. Ingeborg Bachmann n’hésita pas à mettre en lumière cette proximité amoureuse et poétique, voire poétologique, qui la liait à Celan. L’inverse n’est pas vrai ; tout est encore plus ambigu chez Celan. Mais je montre dans le dernier chapitre de mon ouvrage récent que certains poèmes constituent une correspondance cryptée, ou que, pour dire les choses autrement, la correspondance entre eux ne se limite pas aux lettres telles qu’elles furent publiées en 2011 : elle se poursuit dans les poèmes.
Son œuvre romanesque est moins connue en France que sa poésie. Quelles œuvres de prose recommanderiez-vous aux lecteurs français ? Ses nouvelles ? Et plus généralement, par quelle oeuvre commencer ?
La nouvelle « Ondine s’en va » telle qu’elle est traduite dans la revue en ligne Oeuvres ouvertes, et le discours « On peut exiger de l’homme qu’il affronte la vérité » (traduit dans la Revue Europe, n° 892-893 d’août-septembre 2003). Bien sûr également le roman Malina. Et pour ceux qui aborderaient son oeuvre pour la première fois, je suggère Le Journal de guerre (Actes Sud, 2011) et Toute personne qui tombe a des ailes (Gallimard, 2015).
Propos recueillis par Stéphan Alamowitch en juillet 2022
A lire
Françoise Rétif, Ingeborg Bachmann. Ce qui est vrai, Vandenhoeck & Ruprecht , 2021, 114 p.
Françoise Rétif, Ingeborg Bachmann. « Was wahr ist » , Praesens Verlag, Wien, 2022.
Sur Contreligne : Françoise Rétif, Ingeborg Bachmann (1926-1973) : “Qui sait quand ils tracèrent les frontières du pays…” 4 mars 2016