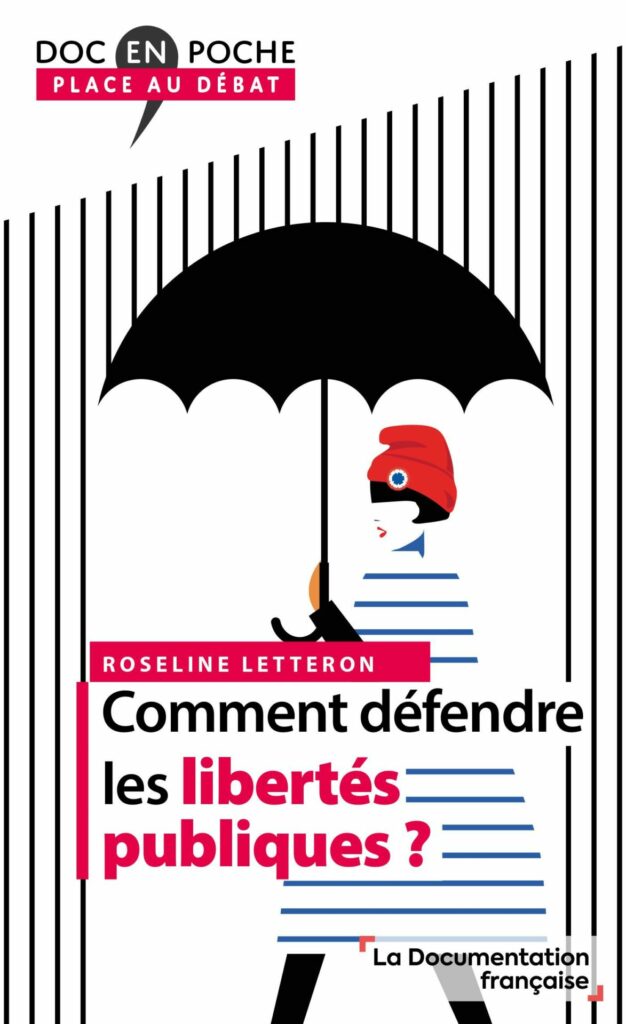
C’est un livre ambitieux que donne Mme Roseline Letteron, professeur de droit à la faculté d’Assas, au sujet des libertés publiques et de leur protection. Il ne s’agit pas d’un traité ni d’un manuel, mais pas non plus d’un mémento qui se bornerait à rappeler les règles essentielles. Le professeur Letteron veut en 150 pages donner au lecteur les principes-clés, venus de l’histoire, des lois et de la jurisprudence, qui fondent et organisent les libertés publiques en France ; elle signale pour chacune d’elles la question contemporaine qui fait débat. L’exercice est réussi et sous ce format modeste, à la Documentation française, le livre est très convaincant.
Définitions
Que sont les « libertés publiques » par rapport aux « droits de l’Homme », aux « droits humains » (que Madame Letteron veut différencier de ces derniers) ? Par rapport aux « libertés fondamentales » ou aux « libertés constitutionnelles » ? Et par rapport aux droits civils, sociaux ou politiques des deux Pactes des Nations-Unis de 1966 ? Ce n’est pas une façon de commencer le propos selon la vieille méthode qui fait tout procéder de définitions, mais la façon de montrer la diversité des fondements et des régimes juridiques associés à chacune de ces formulations. Cette diversité est telle que l’auteur parle d’un empilement de normes.
« Libertés publiques », qui a l’avantage de s’inscrire dans la tradition universitaire française, a surtout pour l’auteur celui de souligner la dimension sociale et collective, publique des droits reconnus, sans hiérarchiser entre eux. On en voit ainsi mieux les évolutions dans le temps et l’espace – et notamment la régionalisation, avec constitution de zones juridiquement homogènes, parce que culturellement homogènes, dans lesquelles un ensemble de droits peut être reconnu dans les mêmes termes ; on pense à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950. Cette régionalisation est un facteur de complexité, complexité qui parfois tourne à l’affrontement entre juges nationaux et juges européens. Ce dialogue est rugueux, dit-elle, plus que le suggère la communication officielle des juridictions.
Le temps joue aussi un rôle. L’auteur souligne que les innovations techniques conduisent à repenser certaines libertés, soit pour leur donner un nouvel objet, soit pour préserver les libertés existantes des atteintes que les technologies pourraient leur porter. Dans le monde numérique, le droit à l’oubli devient une liberté publique. Madame Letteron lui consacre des pages nuancées.
Un chapitre de l’ouvrage, plus attendu, est consacrée à l’absence de Pouvoir judiciaire en France, où il n’existerait qu’une simple Autorité judiciaire. Quand l’on voit ce que deviennent certains pays qui se voient en modèle de Pouvoir judiciaire authentique, les faiblesses de la solution française ne sautent pas aux yeux. Celle-ci doit beaucoup à l’histoire et à un certain esprit jacobin, mais aussi à des faiblesses humaines souvent observées dans la magistrature ces deux derniers siècles et qui restent à corriger. En tout cas, malgré le débat sur les modes de nomination au sein de l’institution1, notre contrôle de constitutionnalité est aujourd’hui plus sérieux et plus précis qu’auparavant. C’est l’effet de l’indépendance gagnée depuis 1958, et la conséquence aussi de la question prioritaire de constitutionnalité introduite lors de la révision de 2008.
Moins attendu ici, le développement sur ce que Madame Letteron nomme l’américanisation du droit. Il ne s’agit pas, sinon à la marge, des procédures accusatoires qui feraient reculer la procédure inquisitoire de notre droit pénal, mais des réformes qui permettent de négocier les sanctions dans un souci de productivité judiciaire, sur le mode du plea bargaining. Elle range aussi dans cette catégorie la création de multiples autorités administratives indépendantes qui se substituent aux vraies juridictions. Cette américanisation peut avoir des effets ambivalents sur les libertés publiques.
La tentation de l’interdit
Plus marquantes sont les pages consacrées à l’aménagement des libertés publiques, lesquelles en France, tous les étudiants l’apprennent, relève du régime répressif2, du régime déclaratoire ou du régime de l’autorisation préalable, le plus strict. Le professeur Letteron montre bien que malgré les tensions politiques et sociales, le Conseil d’État fait toujours prévaloir une conception foncièrement libérale et protectrice des libertés publiques. L’affaire Dieudonné ou celle des casserolades, celle des manifestations pro-palestiniennes récemment ont donné lieu à des décisions du Conseil d’Etat dans le droit fil des jurisprudences de la IIIème République (l’arrêt Benjamin de 1933), et il est bon que ce cap soit maintenu. « L’interdiction devient une tentation de plus en plus fréquente, lorsque les autorités redoutent une irruption de violence. Mais, là encore, le Conseil d’État exerce un contrôle approfondi, conformément à sa jurisprudence traditionnelle », résume-t-elle. Le principe est toujours qu’en l’absence de troubles manifestes à l’ordre public, aucun motif ne justifie une interdiction de s’exprimer ou de manifester. Les appréciations floues de l’autorité administrative ou les concepts ambigus, tel le principe de dignité, n’ont guère convaincu les juges. Tant mieux.

L’administration parait donc bien encadrée. En revanche, pour de bonnes et parfois de moins bonnes raisons, le législateur est, lui, parfois tenté de multiplier les infractions pénales, note le professeur Letteron, et le contrôle constitutionnel devient alors indispensable à la protection des libertés publiques. Elle rappelle le sort de la loi Avia de 2020 visant les contenus « haineux » sur internet, censurée par le Conseil constitutionnel. A ce stade, cette tentation de l’interdit ressentie par le législateur n’a donc pas donné lieu à recul des libertés publiques.
Il existe cependant, ajouterons-nous, une paranoïa dans certains milieux devant cette tentation de l’interdit. La crise sanitaire du COVID, les désordre au sujet du conflit israélo-palestinien par exemple ont été vus comme les occasions par lesquelles un Etat illibéral allait subvertir les libertés publiques. A ce jour, il n’en a rien été3. Cette paranoïa, de posture à notre sens, est classique dans la gauche radicale, mais on la trouve désormais aussi à l’extrême-droite, à preuve les propos du vice-président américain Vance sur la liberté d’expression tout récemment. Liberté d’expression qui serait bafouée en Europe, selon ses dires, au mépris de la sensibilité des électeurs américains (on croit rêver), parce qu’un intégriste chrétien n’a pas pu prier devant une clinique pratiquant l’avortement ou parce que l’expression du racisme est ici un délit pénal4. Quand l’extrême-droite américaine se soucie des libertés publiques en Europe, il faut craindre pour elles et non dire, comme ces éditoriaux imbéciles des Echos ou du Figaro, que le vice-président Vance a peut-être raison et qu’il serait au fond proche de Benjamin Constant5. La liberté d’expression de notre droit positif, qui vient de subir dix ans de remise en cause par la gauche extrême au nom du respect dû à l’Islam, se trouve aujourd’hui ré-attaquée par la droite extrême d’inspiration libertarienne au nom des valeurs de l’intégrisme chrétien6.
C’est sur la laïcité que l’on trouvera les développements les plus intéressants de l’ouvrage. Madame Letteron ne se contente pas d’exposer le principe de laïcité qui découle de la loi de séparation du 9 décembre 1905, et de le ranger au passage parmi les libertés publiques. Elle montre ce qui le sépare du sécularisme américain, peut-être au risque de forcer les différences à notre sens. Elle montre surtout comment la liberté religieuse, autre liberté publique reconnue, et le principe de non-discrimination servent à contester la laïcité et la liberté d’expression au sujet des religions dans les débats européens. « Derrière cette évolution, se profile la menace d’un développement séparé selon l’origine communautaire, sorte d’apartheid juridique qui revient à nier l’état de droit lui-même. », écrit-elle fort justement.
On saura donc gré au professeur Letteron d’être précise et incisive dans des matières où les ouvrages juridiques sont généralement plats et neutres, fades. On lui saura aussi gré de ne pas dissimuler les difficultés que peut poser la protection des libertés publiques quand d’autres intérêts, d’autres valeurs sont en jeu. Rien n’est simple effectivement.
Stéphan Alamowitch
Comment défendre les libertés publiques ? Roseline Letteron, DOCUMENTATION FRANCAISE, Doc En Poche : Place Au Débat, novembre 2024
Notes
| ↑1 | Débat encore récemment illustré de façon calamiteuse en ce mois de février 2025. |
|---|---|
| ↑2 | Qui est, contrairement à ce que le nom indique, le plus libéral. La liberté en cause s’exerce librement, sans autorisation préalable, et l’on répond seulement des abus que l’on en ferait. |
| ↑3 | Compte tenu des évolutions qu’on nous annonce, les choses pourraient changer, hélas. |
| ↑4 | Le Monde – Derrière les mots de J. D. Vance à Munich : le décryptage d’un discours qui a sidéré l’Europe. |
| ↑5 | Voir les tribunes des Echos du 20 février et du Figaro du 21 février 2025. |
| ↑6 | Traditionnellement, l’intégrisme religieux dans ce secteur de l’opinion demandait que l’on restreigne la liberté d’expression. C’est l’inverse aujourd’hui, semble-t-il. |